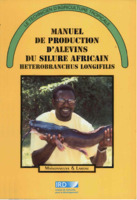Contenus
Taguer
Afrique
-
Élevages au pâturage et développement durable des territoires méditerranéens et tropicaux : connaissances récentes sur leurs atouts et faiblesses
Les élevages de ruminants sont d’importants fournisseurs de denrées alimentaires. Ils contribuent de manière quasiment exclusive aux 883 millions de tonnes de lait produit (FAOSTAT, 2019), dont 81 % proviennent des bovins et 15 % des buffles. En revanche, les bovins et les buffles ne fournissent que 22 % des 337 millions de tonnes de viande, les plus forts contributeurs étant la volaille (39 %) et le porc (33 %). -
Le pastoralisme en Afrique : un mode d'existence en péril?
Quel est le devenir des systèmes pastoraux et agropastoraux en Afrique dans le contexte des mutations rapides et majeures que connaît la région depuis deux à trois décennies et qu’elle connaîtra dans les vingt cinq prochaines années ? Pour un certain nombre d’experts, leur avenir est en question, en raison des obstacles de nature diverse qui pèsent sur leur pérennité. Mais, pour d’autres, des solutions existent. Elles se situent toutes sur le terrain politique : reconnaissance des droits, rétablissement des dialogues inter-communautaires, apprentissage de la gestion partagée des communs ruraux. -
Quelles politiques commerciales et fiscales au service du développement durable des chaines de valeur lait local en AFRIQUE DE L’OUEST ? Propositions aux acteurs Ouest-Africains et Européens
La montée en puissance de la filière lait local en Afrique de l’Ouest constitue un enjeu majeur en termes d’emplois, de revenus, de lutte contre la pauvreté des populations et de développement socio-économique dans les zones pastorales et agro-pastorales dans un contexte de multiplication des conflits et de déstabilisation de la région. L’enjeu du développement de la filière lait local est également essentiel en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’équilibre de la balance commerciale et d’économie en devises. Si la production laitière est en hausse constante depuis vingt ans, la croissance est insuffisante pour faire face à l’augmentation de la demande. Le taux d’autosuffisance en lait de la région qui était de 60% au début du siècle n’est plus que de 41%. Au rythme actuel d’évolution de la consommation et de la production, ce taux ne sera plus que d’un tiers dans deux décennies. -
Manuel de production d'alevins du silure africain : heterobranchus longifilis
Ce manuel propose donc une technologie qui permet la réalisation et l'utilisation en routine d'une unité fiable de production d'alevins de 10 g de Heterobranchus longifilis, selon le principe de l'élevage intensif en structures hors-sol, fonctionnant en circuit ouvert ou en circuit fermé. Nous allons le voir plus loin, l'une ou l'autre option sera prise en compte en fonction de la disponibilité en eau. -
Problèmes d'environnement dans les programmes de lutte de l'USAID contre les locustes et les sauterieaux
L'US Agency for International Development (USAID) ct un certain nombre d'autres pays donateurs ont aidé les pays d'Afrique ct du Proche-Orient dans leur lutte contre les locustes et les sauteriaux pendant la période d'invasion des années 1986-89. Dans cette lutte, ce furent surtout des insecticides qui furent utilisés pour réduire immédiatement la population acridienne. Le présent document relate les efforts de protection de l'environnement accomplis et accomplir par I'USAID lors de toute application d'un programme recourant aux pesticides. -
Recherche et étude génétique de la resistance de l’aubergine africaine (Solanum aethiopicum L, spp Kumba) aux acariens phytophages
Les légumes de type africain, qui pendant longtemps ont été considérés comme secondaires, sont de nos jours progressivement pris en compte aux niveaux national et international. Ceci s’explique par leur valeur nutritive dans l’alimentation des zones rurales et le risque réel d’érosion génétique dont ils sont aujourd’hui menacés. Les aubergines africaines regroupent plusieurs espèces dont Solanum macrocarpon,S. anguivi et S. aethiopicum. Cette dernière, appelée jaxatu au Sénégal, est très répandue en Afrique sous diverses formes variétales, et porte différents noms vernaculaires suivant les ethnies et les pays. -
Reconnaitre la peste des petits ruminants
L'objectif de ce manuel est de faire en sorte que tous ceux qui sont concernés par la santé animale des petits ruminants « pensent PPR» et soient capables de la reconnaître rapidement, dès son apparition. Les commentaires et suggestions des lecteurs visant à améliorer le contenu de ce manuel seront les bienvenus. -
Atelier International sur le lait de chamelle en Afrique
Les données de la littérature sur la productivité laitière de la chamelle sont relativement rares et essentiellement issues d'observations réalisées en station, beaucoup plus rarement en milieu pastoral réel. Par ailleurs, les règles de mesure ne sont jamais mises en œuvre de façon homogène d'un auteur à l’autre : quantité moyenne quotidienne, quantité totale, quantité par an, moyenne de troupeau etc... De ce fait les comparaisons sont quelquefois acrobatiques. Il apparaît par ailleurs une très forte variabilité des productions déclarées laissant supposer un potentiel de sélection sur ce critère tout à fait envisageable, mais rarement entrepris à l'exception de travaux de l'époque soviétique en Asie Centrale. -
Agriculteurs et accès au financement : quel rôle pour l’État?
Cet article dresse un panorama des besoins et des difficultés d’accès au financement des exploitations familiales. Il revient sur les différentes stratégies qui ont été mises en œuvre depuis les indépendances pour permettre à ces agricultures d’accéder au crédit et souligne les défis qui restent à relever. -
L'apiculture en Afrique : les pays du nord, de l'est, du nord-est et de l'ouest du continent
C'est une présentation de l'apiculture des pays de quelques régions d'Afrique: Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie), de l'Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda), du Nord-Est (Djibouti, Éthiopie, Somalie, Soudan) et de l'Ouest (Bénin, Burkina, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte-d'Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo). La revue concernant ces 26 pays porte sur les races d'abeilles mellifères, y compris les races africaines, les plantes mellifères, la production de miel et d'autres produits de la ruche, les prédateurs et les maladies des abeilles mellifères, la chasse au miel, l'apiculture traditionnelle avec des ruches traditionnelles, l'apiculture moderne qui emploie des ruches modernes. On présente également des données sur l'histoire de l'apiculture, les activités de recherche et les pionniers de la recherche apicole dans ces pays, à l'exception toutefois du Mali, du Niger et de Sierra Leone. Les recherches les plus nombreuses ont été conduites en Égypte, en Tanzanie, en Éthiopie, au Nigeria et au Sénégal. Les projets, les associations professionnelles, les stages de formation, les publications spécialisées, les séminaires, ateliers et conférences organisés dans ces pays sont également cités. L'apiculture de ces pays africains réclame pour son développement plus d'organisation, de coopération, de modernisation, de formation, d'extension et de recherches. -
Développement de l'Industrie agroalimentaire pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté
L’ONUDI, qui est l’un des parrains de la Facilité d’Assistance Technique (TAF) du Fonds Africain pour l’Agriculture (AAF), encourage une offre de services d’assistance technique de qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en Afrique. La TAF a été créée pour étendre la portée, en matière de développement, des investissements privés de l’AAF, un fonds de capital investissement équitable créé pour accroître et diversifier la production et la distribution alimentaire en Afrique. L’ AAF est financé par des institutions financières européennes et africaines pour le développement et géré par Phatisa, une compagnie de gestion de fonds privés basée en Afrique du Sud. -
Nourrir l'Afrique : stratégie pour la transformation de l'agriculture africaine 2016-2025
La présente Stratégie vise à intensifier les efforts antérieurs, et non à faire double emploi avec ceux-ci, à travers la mise à l’échelle des interventions en cours et couronnées de succès sur le continent, tout en développant davantage les capacités requises des acteurs, tant publics que privés, intervenant dans l’ensemble du système, de façon à pérenniser les impacts positifs de ces interventions. Le Groupe de la Banque africaine de développement est bien placé pour jouer un rôle particulièrement important dans une telle transformation, à travers la présente Stratégie, en agissant comme catalyseur de tels efforts, notamment à travers l’utilisation, entre autres atouts, aussi bien de son levier financier pour mobiliser les investissements nécessaires que de son pouvoir de mobilisation pour amener les différents partenaires autour d’une même table et renforcer l’obligation de rendre compte. -
La santé animale : Principales maladies
A l'occasion de la traduction en français de l'ouvrage Animal health (volume 2) d'Archie Hunter (1994), un collectif de spécialistes, en majorité du Cirad, coordonnés par Christian Meyer, a révisé et actualisé le texte, pour tenir compte des avancées scientifiques et techniques récentes dans ce domaine. -
Les agriculteurs à l'ère du numérique
Dans les pays ACP, les femmes qui essaient de développer des agroentreprises prospères se heurtent à d’importants obstacles : accès au marché, aux informations sur le marché, aux services financiers et autres… Souvent, elles ne possèdent pas les compétences techniques, de management et de leadership nécessaires à la gestion d’une entreprise dans la durée. L’autonomisation des femmes, qui doit leur donner les moyens de surmonter ces difficultés, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes sont donc des volets clés du travail du CTA. Et les TIC peuvent ici réellement changer la donne en créant un environnement propice aux femmes et aux jeunes et à leur autonomisation. -
Manuel de formation pour l'amélioration du traitement et du stockage des grains après-récolte
Ce manuel est destiné aux formateurs des organisations paysannes (OP) et à leurs membres en Afrique sub-saharienne. Le but étant de fournir une formation sur les techniques et opérations après-récolte afin d’améliorer la qualité des grains et ainsi de permettre l’augmentation des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire des agriculteurs participants au programme. -
L’engagement de Maputo : le mot d’ordre a-t-il été respecté ?
Alors que les chefs d’État africains avaient en 2003 pris l’engagement de consacrer 10 pourcents de leur budget national à l’agriculture conscients de son l’importance dans le développement économique, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire, le secteur agricole reste marginalisé en Afrique au regard de la faiblesse des investissements publics notée dans ce domaine. -
Promouvoir une année internationale de la Protection des Végétaux
En 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution pour proclamer 2020 Année Internationale de la Protection des Végétaux. Il s’agit d’une occasion unique de sensibiliser le monde sur la manière dont la protection des végétaux peut contribuer à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger l’environnement et à stimuler le développement économique, et souligner l’importance des organisations phytosanitaires internationales, régionales et nationales. -
La protection des variétés végétales en Afrique de l'Ouest et Centrale
Les méthodes agricoles traditionnelles et les variétés végétales sont chargées de couvrir la grande majorité des besoins nutritionnels et médicinaux des populations de l'Afrique de l’Ouest et centrale. Les régimes du droit international et régional de la propriété intellectuelle sont analysés comme une possibilité d'instrument juridique pour la protection de ces méthodes traditionnelles agricoles et des variétés végétales. Toutefois, comme le document le démontre, ces moyens conventionnels de protection juridique ne peuvent pas nécessairement satisfaire les besoins des gens qui tentent d'assurer l'accès et la capacité à fournir de la nourriture et des médicaments suffisants pour leurs communautés. -
Les plantes parasites dans l'agriculture africaine
Cette Note Technique donne un aperçu des plantes parasites d’importance agricole en Afrique. Les herbes parasites provoquent un stress de sécheresse et un retard de croissance au niveau des cultures. Les plantes affectées comprennent les céréales (par exemple, le sorgho [Sorghum bicolor] et le maïs [Zea mays]), ainsi que les légumineuses à grains (par exemple, le niébé [Vigna unguiculata]) dont les agriculteurs dépendent pour leur nourriture. Les dégâts causés à ces cultures et à d’autres cultures sont généralement aggravés par la faible fertilité du sol et le stress de sécheresse, conditions auxquelles de nombreux petits exploitants africains sont confrontés. Les herbes parasites peuvent entraîner de graves pertes de rendement, ce qui fait d’elles un obstacle important à la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. -
Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités
Cette étude présente les principaux résultats d’un travail réalisé en 2012 pour la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde. Elle s’appuie sur trois rapports détaillés analysant la situation des organisations de producteurs dans deux pays d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso et le Ghana, et un pays d’Afrique du Centre, le Cameroun. -
Préparation de la 2èm réunion ministérielle Afrique-Arabe sur le développement Agricole et la sécurité alimentaire
L'Afrique subsaharienne possède assez de terres arable et de main d’œuvre pour parvenir à l'autosuffisance en matière de nourriture. Cependant, la production alimentaire s'y heurte à des obstacles principaux tels que la pénurie d'intrants comme l'eau et les engrais. L'agriculture dans cette région du sud du Sahara dépend des pluies ce qui l'expose aux fluctuations de la pluviométrie et rend difficile l'arrivée à la production maximale. Dans ce contexte, les petits réservoirs d'eau constituent l'une des solutions envisageables pour limiter cette exposition. -
Jujubier
Le jujubier est plastique et rustique. Il aime les sols sableux à limoneux, bien drainés, de pH neutre ou légèrement alcalin. Il supporte une faible fertilité du sol et une grande variété de climats mais on le trouve principalement dans des zones avec une longue saison sèche. -
Manuel visuel des bonnes pratiques apicoles à l’usage des petits apiculteurs d’Afrique
La présente publication est un manuel visuel et pratique sur l’apiculture durable destiné aux petits apiculteurs des régions rurales d’Afrique. Elle a été conçue pour servir de guide de formation sur l’apiculture et a vocation à devenir un document de référence sur les bonnes pratiques apicoles élémentaires à l’usage des petits apiculteurs. Son objectif consiste à transmettre aux producteurs de miel les connaissances nécessaires pour élever des abeilles, mais également produire et récolter du miel de façon durable. Ce manuel ne prétend pas être exhaustif; il est volontairement concis afin de livrer aux petits apiculteurs d’Afrique les informations les plus fondamentales et les plus utiles sur l’apiculture. Il ne donne donc pas d’informations détaillées sur les activités postérieures à la récolte, qui doivent idéalement être réalisées dans un bâtiment spécifique (miellerie). -
Manuel de formation en agriculture biologique pour l’Afrique
Plus de 60 pour cent de la population d’Afrique subsaharienne vit en zone rurale et dépend de l’agriculture comme source principale de revenus. La dominance de l’agriculture dans les économies africaines fait de ses performances un facteur majeur du développement économique sur ce continent. Malgré de vastes terres arables qui pourraient nourrir les Africains et produire des surplus pour l’exportation, la sous-alimentation et la famine y sont très répandues et continuent même d’augmenter. Aujourd’hui, l’Afrique est un importateur net de nourriture et son déficit de la balance du commerce agro-alimentaire est également grandissant. La basse productivité du travail agricole et des terres est une indication claire du potentiel inexploité des fermes africaines. -
Améliorer la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique
Cet ouvrage porte sur l'amélioration de la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique -
Problématique de trois systèmes irrigués en Afrique (Fleuve Niger, Fleuve Sénégal, Lac Alaotra) : Bilan et évolutions institutionnelles
La libéralisation des économies, les phénomènes généralisés de croissance démographique et d’urbanisation ouvrent de larges perspectives, d’une part, aux productions vivrières locales et en particulier à la riziculture qui devrait rester largement dominante sur les périmètres, et d’autre part, aux autres productions irriguées (fruits et maraîchage notamment). Le marché n’est pas une contrainte au développement de ces productions sous réserve de leur compétitivité et de leur accessibilité aux circuits de commercialisation. -
Parcs agroforestiers sahéliens : de la conservation à l’aménagement
Au Nord-Cameroun, comme dans l’ensemble des zones semi-arides africaines, les agriculteurs ont depuis longtemps défriché les savanes arborées pour les mettre en culture. Ce défrichement a souvent été sélectif : les cultivateurs ont conservé les arbres peu gênants ou utiles. Par la suite, ils ont parfois enrichi ces systèmes agroforestiers en introduisant de nouvelles espèces ou en conservant une partie de la régénération naturelle. En fonction de la composition du peuplement arboré d’origine, des conditions écologiques, des savoirs et des besoins des populations et de leur environnement socio-économique, différents types de parcs arborés se sont ainsi construits, dont les plus connus sont les parcs à faidherbia (Faidherbia albida) et les parcs à karité (Vitellaria paradoxa).