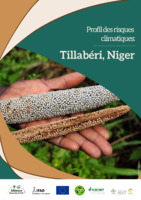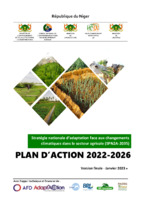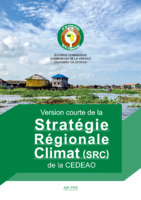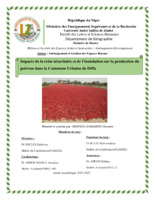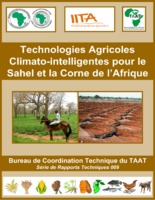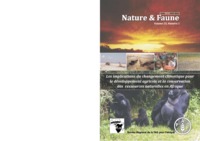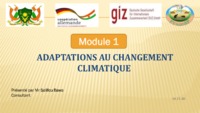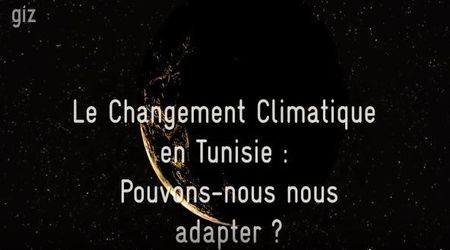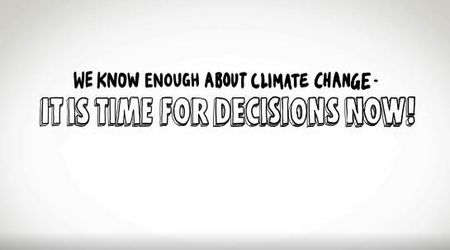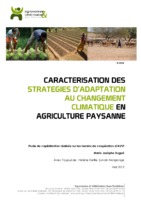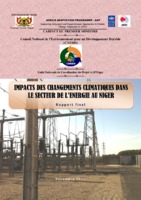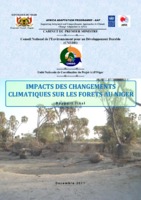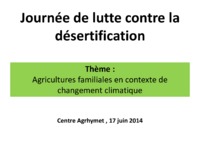Contenus
Site
Bibliothèque numérique DUDDAL
thème principal est exactement
Changements climatiques et adaptation
-
Impacts potentiels du changement climatique sur les rendements du mil et du sorgho cultivés dans les communes rurales au Niger
Le changement climatique constitue une menace majeure pour les populations de l’Afrique de l’Ouest, en général et du sahel, en particulier. Le Niger est, pleinement, concerné par cette situation qui se traduit par une grande variabilité pluviométrique et une forte récurrence de sècheresses depuis les années 1970s. Cette étude analyse l’impact du changement climatique sur les rendements du mil et du sorgho dans les Communes rurales de Balleyara, Dan Issa, Dogo, Harikanassou, Illéla, Magaria et Mokko, au Niger. Deux variétés de mil (HKP et SOMNO) et une de sorgho (Caudatum) ont été testées. -
Rapport de session d'écoute dans les villages et auprès des leaders dans les régions sahéliennes du Niger, du Burkina Faso et du Mali
Dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience et d’Adaptation aux Extrêmes Climatiques et Désastres (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters -BRACED- Programme) de l’Agence de Coopération Britannique (DFID), CRS en tant que chef de file d’un consortium, avait soumis en novembre 2013 une note conceptuelle pour le projet SUR1M (Scaling Up Resilience for 1 Million people), un projet se proposant de couvrir 30 communes situées dans le bassin versant du fleuve Niger, en zone du Sahel. Treize de ces communes sont situées au Niger, dix au Burkina et 7 au Mali. La note ayant été approuvée en décembre 2013, CRS a lancé une enquête en mars 2014 pour recueillir les points de vue des bénéficiaires potentiels du projet et des leaders des communes ciblées. -
Adaptation de l'agriculture au changement climatique au Sahel : profils agronomiques de quinze cultures dominantes au Sahel
Le présent document fait partie d’une série d’études publiées par le projet Résilience africaine et latino-américaine au changement climatique (ARCC) visant à répondre aux besoins d’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest. Dans le cadre des études ARCC pour l’Afrique de l’Ouest, le présent document fait partie de la sous-série portant sur l’Adaptation de l’agriculture au changement climatique dans le Sahel. L’ARCC a également produit une sous-série sur le Changement climatique et les ressources en eau d’Afrique de l’Ouest, le Changement climatique et les conflits en Afrique de l’Ouest et le Changement climatique au Mali. -
Changement climatique et intrants agricoles en Afrique avec un accent particulier sur les variétés tolérantes à la sécheresse
Les changements climatiques expriment toute évolution du climat dans le temps, qu’elle soit due à la variabilité naturelle ou aux actions humaines. Les changements climatiques ont donc des impacts sur la température, les précipitations, les sécheresses, les inondations, les élévations du niveau de la mer qui ont des conséquences sur la Sécurité alimentaire ; l’approvisionnement en eau et sur la Santé humaine. L’Afrique, qui n’émet que 4% en équivalent CO2 de gaz à effet de serre, est gravement touchée par le phénomène de changement climatique. En effet, les travaux du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, indiquent que les changements climatiques engendreront des risques de chute des rendements de l’agriculture pluviale de l’ordre de 50% d’ici 2020 et une augmentation des superficies arides et semi-arides de 5 à 8% d’ici 2020. L’agriculture ouest-africaine généralement pluviale, demeure donc très sensible aux mauvaises conditions météorologiques, qui provoquent des baisses de production alimentaire et engendre régulièrement des crises alimentaires. -
Variabilité climatique au Niger : Impacts potentiels sur la distribution de la végétation
Dans le Sahel ouest-africain et au Niger en particulier, les systèmes d’élevage notamment celui de tradition pastorale, traversent une crise sans précédent. Située dans l’extrême sud-ouest du pays, la région de Dosso est une zone agropastorale où la problématique de la mobilité pastorale se pose avec acuité. C’est ainsi que cette étude se propose d’identifier les différentes formes de contraintes liées à la mobilité pastorale afin de dégager quelques pistes d’actions qui contribueront à sécuriser davantage cette pratique et à atténuer les risques de conflits. L’approche méthodologique intègre à la fois la combinaison des états des connaissances existantes, des enquêtes socioéconomiques à travers un questionnaire, un guide d’entretien et la cartographie. Depuis 2003, les sites du dispositif national de surveillance environnementale (DNSE) du Niger mis en place par le Réseau d’Observatoire et de Surveillance Écologique à Long Terme (ROSELT) avec l’appui de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) ont permis de collecter et de traiter les données écologiques selon des méthodologies harmonisées favorisant ainsi les comparaisons spatio-temporelles. Les données floristiques et phytoécologiques ont été relevées suivant la méthode phytosociologique de Braun-Blanquet. Les attributs vitaux analysés se rapportent à la diversité spécifique, la diversité alpha, l’équirépartition, les types biologiques et phytogéographiques et la phytomasse herbacée. À l’échelle du dispositif, l’analyse a montré que la diversité spécifique, la diversité alpha et la phytomasse sont plus importantes dans les biotopes peu perturbés des bioclimats nord soudanien et sud sahélien marqués par une pluviométrie relativement favorable. Dans les bioclimats nord sahélien et saharien, la topographie peut jouer localement un rôle prépondérant dans la redistribution de cette phytodiversité. Sur l’ensemble du dispositif, la distribution des types biologiques montre une dominance des thérophytes dans tous les bioclimats (56,8±11%). Les espèces pérennes viennent en seconde position et déterminent 26,5±7,3%, avec des valeurs supérieures pour les biotopes du bioclimat nord soudanien. -
Profil des risques climatiques des chaînes de valeur des principales cultures de la Région de Tillabéri, Niger
A l’instar des régions du Niger, l’agriculture de la région de Tillabéri fait face à plusieurs conséquences néfastes du changement climatique affectant le développement agricole de la région. Cependant, il existe diverses potentialités pour développer ce secteur agricole afin de mieux supporter les chocs climatiques telles que l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC). C’est ainsi que depuis 2011, le programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité alimentaire (CCAFS) met en œuvre au Niger, un projet de développement de chaînes de valeur et paysage climato-intelligents pour accroitre la résilience des moyens de subsistance. Ce projet s’articule autour de trois activités principales, à savoir (i) l’analyse des chaînes de valeur afin d’identifier les risques climatiques et autres contraintes auxquelles font face les chaînes de valeur et qui pourraient être résolues par des options climato-intelligentes, (ii) l’intégration d’options agricoles climato-intelligentes (AIC) fondées sur des évidences dans les chaînes de valeur sélectionnées par le biais des plateformes d’innovation multipartites et (iii) l’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’analyse de chaînes de valeur climato-intelligente. -
Impacts des variations du niveau du lac Tchad sur les activités socio-économiques des pêcheurs de la partie nigérienne
Vaste étendue d’eau située au cœur du Sahel, aux confins de quatre États limitrophes (Tchad, Cameroun, Nigeria, et Niger), le lac Tchad constitue une aire d’activités socio-économiques cruciale dans la région. Cependant, ces activités sont très sensibles à la grande variabilité de la surface en eau du lac, gouvernée par les fluctuations interannuelles de la pluviométrie sur son bassin, affectant significativement les paysages et les ressources naturelles. Dans cette thèse, l’impact de la transition entre une phase humide (1950-1970) et une phase de relative sécheresse (1973-présent) sur les activités en lien avec la ressource halieutique sont étudiées, en considérant plus particulièrement la cuvette nord (partie nigérienne) du lac Tchad. -
Vulnérabilité et stratégie d'adaptation des agro-pasteurs face aux aléas climatiques dans la commune de Falwel (Dosso) au Niger
La variabilité et le changement climatique influencent beaucoup le secteur de l’Agriculture au Niger. Conscients de cette situation, les agro-pasteurs initient des stratégies de résiliences pour s’adapter. C’est dans ce contexte que se situe le présent travail qui vise principalement à renforcer la capacité de résilience des agro-pasteurs de la commune rurale de Falwel face aux impacts néfastes des aléas climatiques. Pour ce faire, 180 agro-pasteurs et des personnes ressources ont été enquêtés dans sept (7) villages de la commune et une séance de « focus group » a été organisée dans chaque village. Les données météorologiques de la pluviométrie, la température moyenne minimale et maximale de la période de 1981 à 2020 de la station MESA de l’ARHYMET de Falwel ont été analysées. Les résultats des analyses climatiques montrent une tendance des précipitations à la baisse tandis que celle des températures est à la hausse. Selon une forte majorité des enquêtés (99,7 %), les phénomènes extrêmes climatiques majeurs perçus sont la sécheresse, la hausse des températures, les inondations et les vents violents causant la dégradation des ressources fourragères. Le tarissement des points d’eau temporaires est perçu par 95,6 % des enquêtés. La disparition de certaines espèces végétales plus appétées par les animaux et l’apparition d’autres envahissantes sont perçus également par la quasi-totalité des agropasteurs. Ainsi, la baisse des productions fourragères et l’exacerbation des conflits ont été observées par 88,9 %, 57,2 % respectivement des agropasteurs. En réponse à ceux-là, plusieurs stratégies d’adaptation ont été développées par les agropasteurs, les services techniques de l’état et les ONG. -
Guide méthodologique d'animation et de sensibilisation des communautés en Gestion Durable des Terres, Désertification et Changement Climatique
Le présent guide est conçu pour soutenir les animateurs/formateurs de LEAD Tchad afin que ces derniers soient capables à leur tour d’accompagner, à travers l’animation/la sensibilisation, les communautés rurales à prendre conscience des enjeux de gestion des risques climatiques, des ressources naturelles en général et des terres en particulier et à prendre des initiatives conséquentes. Concernant le public cible (communautés rurales), une attention particulière doit être accordée aux femmes qui constituent un groupe d’acteurs clés du fait de leur fort effectif numérique et de leur plus grande implication dans l’exploitation/gestion quotidienne des ressources naturelles. Il s’agit d’un outil pédagogique comportant trois (3) grands modules notamment la Gestion Durable des Terres (GDT), la désertification et le Changement Climatique (CC). Chaque module constitue une unité pédagogique d’apprentissage pour les apprenants et se détermine par un objectif pédagogique précis. En effet, le module est constitué d’un agencement de plusieurs séquences (fiches) dépendantes linéairement les unes des autres. La cohérence de l’enchainement de ces séquences (fiches) permet l’atteinte de l’objectif pédagogique. Chaque séquence (fiche) est structurée en six (6) parties notamment les objectifs spécifiques, le contenu, les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques, la durée et le suivi/évaluation. -
Résilience des communautés rurales face à la crise écologique et foncière du Sahel : l'exemple de la vallée d'Arewa (Niger central)
La vallée d’Arewa se situe dans l’arrondissement de Madaoua au sud de la région de Tahoua, à environ 80 kilomètres de la frontière nigériane, pays avec lequel les échanges commerciaux sont très importants (cf. figure 1). Elle appartient à une des plus grandes zones de production agro-pastorale du Niger. Incisée dans la bordure orientale des plateaux de l’Ader Doutchi, elle rejoint la basse vallée de la Tarka dont elle est un des principaux affluents. S’allongeant sur environ 30 kilomètres, elle présente, de l’amont vers l’aval, différents faciès morpho-pédologiques et différentes conditions hydrodynamiques, d’où une certaine diversité des systèmes d’exploitation. -
Étude du Sahel : rapport étude pilote Niger
L’étude pilote au Niger sert à préparer un étude, menée sous la responsabilité du CILSS, sur les expériences réussies en matière de gestion des ressources naturelles au Sahel et leurs impacts sur l’agriculture, l’environnement et la pauvreté rurale..Cette étude du Sahel part de l’hypothèse de base selon laquelle les succès enregistrés dans les domaines de l’agriculture et de la GRN au Sahel sont sous-estimés. Un eseconde hypothèse est que l’impact des réformes politiques et institutionnelles que les pays ont introduites dans la sous-région n’est pas apprécié à sa juste valeur. Une troisième hypothèse est qu’il y a une sous-estimation des capacités et compétences des communautés de base en matière de coopération et de gestion des questions liées à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. -
Vers la promotion des systèmes de production résilients aux changements climatiques
Pays sahélien et enclavé, le Niger couvre une superficie de 1.267.000 km2. 77% du pays sont occupés par des déserts dont celui du Ténéré qui compte parmi les déserts les plus célèbres du monde. Outre la zone saharienne désertique, on distingue parmi les zones climatiques au Niger (i) la zone sahélo soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale et qui reçoit 600 à 800 mm de pluie en moyenne par an ; (ii) la zone sahélienne qui couvre 10% de la superficie et qui reçoit 300 à 600 mm de pluie en moyenne par an et ; (iii) la zone sahélo saharienne qui représente 12% de la superficie et qui reçoit 150 mm à 300 mm de pluie en moyenne par an. -
The causal nexus of Trans-Saharan migration: A political ecology approach from Niger
Increased Trans-Saharan migration over the past decade has spurred arguments that climate change or generic conditions of poverty drive West Africans to take this risky journey. These diagnoses are made with little empirical investigation of the conditions facing migrants and their families at home. This article reports on mixed-methods research conducted in southwestern Niger within ten communities where Trans-Saharan migration has recently begun, with interviews conducted at community, household and individual scales. Interviews were conducted within 331 households with or without members involved in Trans-Saharan migration. Individual interviews were also conducted with 67 returned Trans-Saharan migrants and 100 community youth who represent potential Trans-Saharan migrants. We find no evidence that new rainfall fluctuations influence the onset of Trans-Saharan migration. Study communities and migrant families within them are not poorer nor more food insecure than other communities or non-migrant families. The sole difference is that migrant families have more adult men. Interviews with returned Trans-Saharan migrants point to a mix of individual and family motivations for embarking on risky journeys north. A key factor is desperation – driven not by short-term scarcities but by a hopelessness due to life-long experiences of crushing poverty, past periods of recurrent drought, soil impoverishment, and political voicelessness. They go, despite knowing the grave abuses and risks they may face. -
Note sur la situation économique : renforcer la résilience financière des éleveurs face à la sécheresse
Cette note sur la situation économique du Niger 2023 s’articule en deux chapitres. Le premier chapitre présente les évolutions économiques et de la pauvreté observées dans le pays en 2022 ainsi que les perspectives de 2023 à 2025. Ce chapitre est suivi d’un résumé des analyses d’impact macroéconomique et de pauvreté pour le Niger dans le rapport CCDR du Sahel (2022). Le chapitre 2 propose une analyse approfondie du potentiel du financement des risques de catastrophe et des instruments d’assurance pour réduire les impacts socio-économiques négatifs des chocs climatiques. -
Implication du secteur privé pour renforcer la résilience de l’agriculture du Niger au changement climatique : évaluation du marché de l’assurance agricole
Dans le cadre de la phase de pré-mise en œuvre de « l’investissement dans le secteur privé pour construire la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger », la SFI (société financière internationale) - services consultatifs - a entrepris trois projets d'investissement avec le soutien financier du Fonds climatique d'investissement stratégique (SCF) dans le cadre du programme du PPCR au Niger. Le PPCR se focalise sur le pilotage des interventions dans les pays en développement pour la gestion des risques liés au climat et le renforcement de l'agriculture résiliente au changement climatique. -
Réponses spontanées aux changements climatiques : tentatives d'adaptation dans la commune de Ibohamane (Centre Nord Tahoua au Niger)
Au Niger, l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques qui en découlent sont partout pris en compte dans les systèmes agraires. Les mécanismes classiques sont basés sur les cultures irriguées, les activités génératrices de revenu, la complémentarité entre spéculations et entre espaces utilisés au sein des exploitations. En effet, la péjoration climatique se traduit localement par des perturbations qui modifient ces activités de production. Dans ces conditions, l’agriculture doit s’adapter et pour y faire face, les producteurs développent des mesures d’adaptation diverses des producteurs en situation de crises climatiques. La méthodologie de cette étude s’est appuyée sur l’analyse des relevés pluviométriques des stations de Madaoua, Keita et Bouza de 1950 à 2016 et une enquête auprès d’un échantillon de 160 chefs d’exploitation agricoles. Les résultats montrent que depuis la mise en eau du barrage de Tegueleguel, les cultures irriguées ont connu un regain avec des choix des spéculations. Il est apparu aussi des modifications du calendrier agricole, l’utilisation des variétés de semences et la réhabilitation des certaines pratiques de gestion durable des terres (les Zaï). Aussi, les perceptions des producteurs ont été appréhendées ainsi que les stratégies de riposte mises en évidence. -
Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC) : bilan de mise en œuvre
Le Gouvernement du Niger a reçu un crédit IDA de III millions USD pour financer les coûts du Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux risques Climatiques (P ASEC). L'Accord de financement du Projet a été signé le 21 juin 2016 et mis en vigueur le 30 Novembre 2016. Le PA SEC s'inscrit dans le cadre de l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) et ses actions s'inscrivent aussi dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'Alliance mondiale pour une agriculture climato-intelligente (Climate Smart Agriculture) dont le Niger est un des membres fondateurs. En effet, l'Alliance vise à adapter les pratiques agricoles, les filières alimentaires et les politiques sociales pour qu'elles prennent en compte les changements climatiques et utilisent de manière efficiente les ressources naturelles. Les objectifs de développement du projet (ODP) proposés sont d'accroître la résilience face aux risques climatiques et d'améliorer la productivité agricole au niveau des communautés ciblées. Le projet aidera aussi à améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement à toute situation de crise ou d'urgence éligible. -
Stratégie nationale d’adaptation face aux changements climatiques dans le secteur agricole (SPN2A-2035) : Plan d'Action 2022-2026 Version finale 2023
Ce plan d’action a été élaboré en suivant une démarche concertée et itérative mobilisant une série de rencontres avec les acteurs des institutions et services techniques de l’État, incluant en particulier les Directions des Études et de la Programmation des Ministères sectoriels. La définition des cibles d’activité et le dimensionnement des budgets correspondants ont été alignés sur les stratégies nationales et sectorielles existantes. -
Évaluation des besoins en technologies d'atténuation des émissions des gaz à effets de serre
Il est désormais bien établi que les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) provenant des activités humaines sont à l’origine du réchauffement climatique qui affecte l’écosystème planétaire et provoque des variations extrêmes du climat. Les risques du changement climatique représentent ainsi un des plus importants défis du 21ème siècle post-industriel au développement de l’humanité, voire même à l’avenir de la planète. Pour faire face à cette situation, la communauté internationale s’est mobilisée, dès 1992 lors de la conférence de Rio, en adoptant la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), véritable cadre de discussions permanent totalisant 196 parties et auquel 168 pays du monde ont aujourd’hui adhéré. -
Plan d'Investissement pour la région du Sahel : volume 2 (PIC-RS 2018-2030) Rapport final
Le processus d’élaboration d’un Plan d’Investissements Climat pour la Région du Sahel tire son fondement du « Sommet Africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale » tenu le 16novembre 2016 à Marrakech, à l’initiative de Sa Majesté, le Roi Mohammed VI du Maroc et qui a regroupé plusieurs Chefs d’État et de délégation d’Afrique, en marge de la 22ème Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22). Il s’agit, pour l’Afrique, de traduire son « ambition de s’inscrire dans un sentier de co-émergence durable, en construisant son propre modèle de développement inclusif et durable, répondant ainsi aux aspirations légitimes des populations africaines et préservant les intérêts des générations futures ». -
Elaboration de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes au Niger
Comme toute stratégie, les orientations de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe découlent d’une vision partagée et d’un processus de planification axée sur les résultats, c'est-à-dire d’une projection dans l’avenir, des changements souhaités et des étapes intermédiaires à franchir avant d’y arriver. L’ambition de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe est que le Niger puisse réduire de façon significative sa vulnérabilité structurelle aux catastrophes pour entrer véritablement dans le processus du développement durable. -
Stratégie Nationale et du Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (SNPACVC) révisée
Dans un pays sahélien comme le Niger où les impacts des risques climatiques constituent des contraintes majeures dans les secteurs clés pour le développement socio-économique, la disponibilité d’une Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Changements Climatiques (SNPACC) revêt une importance capitale dans le cadre du développement durable. C’est dans cette optique que dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme Africain pour l’adaptation aux Changements Climatiques (PAA), le SE/CNEDD a entrepris la mise à jour de la Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (SNPACVC) qui a été élaborée en 2003. L’actualisation de cette stratégie permettra de prendre en compte certaines thématiques émergentes notamment la réduction des risques de catastrophes naturelles, la Politique Nationale en matière de Changements Climatiques (PNCC), l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (I3N) et le Plan de Développement Économique et Social 2012-2015 (PDES 2012-2015). -
Évolution récente des extrêmes pluviométriques au Niger (1950-2014)
L’Afrique de l’Ouest est la région du monde qui connait le déficit pluviométrique le plus important. Le Niger, l’un des pays les plus pauvres du monde, est hautement dépendant des variations pluviométriques dans un contexte de réchauffement climatique dont les conséquences semblent être défavorables dans les décennies à venir. Sur base des données pluviométriques quotidiennes de 37 stations nigériennes, cet article analyse l’évolution des précipitations au travers de onze indices entre 1950 et 2014. Après une sévère sécheresse de trois décennies qui est individualisée de 1968 à 1997, il apparait que si un retour à une pluviométrie moyenne annuelle subnormale est observé depuis 1998, il n’en est rien pour d’autres indices vitaux pour le monde rural dépendant de la bonne distribution des précipitations durant la saison des pluies. En effet, les jours secs consécutifs ont considérablement augmenté et les jours humides consécutifs se sont réduits. Il en va de même pour les jours pluvieux. Dans le même temps, la proportion de la précipitation maximale quotidienne dans le total pluviométrique annuel s’est renforcée au fil du temps et la proportion des précipitations intenses dans le total pluviométrique annuel s’est significativement accentuée au cours des deux dernières décennies. -
Évaluation carbone du "Programme d'Action Communautaire - Résilience au Changement climatique" au Niger
Le Niger a lancé le programme d’action communautaire (PAC2) en 2008. Le PAC2 a pour objectif de rendre les communautés rurales mieux à même de concevoir et mettre en œuvre de manière participative des plans de développement, ce qui contribuera à une amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. Ce projet collabore avec des institutions nationales chargées de promouvoir la décentralisation et le développement local dans le cadre de la stratégie de développement rural du Niger. -
Élevage bovin et environnement : les chiffres clés
Dans les exploitations d’élevages bovins, les ateliers "végétal" et "animal" sont étroitement liés. Le premier fournit la majorité des fourrages consommés par les animaux (autonomie alimentaire en matière sèche fourrage de 98 %, pour l’ensemble des systèmes bovins nationaux), ainsi qu’une partie non négligeable des aliments concentrés ingérés (autonomie massique de 28 % en moyenne) (source : CIV). L’atelier animal produit des déjections valorisées sur ces surfaces, soit directement sur les prairies lors du pâturage, soit par épandage. Sur l’ensemble des élevages bovins français, plus de 60 % des apports azotés sur les surfaces exploitées sont de nature organique et proviennent majoritairement de l’exploitation elle-même. -
Inventaire des connaissances sur la résilience climatique au Niger
Cette étude fait état de l’ensemble de travaux antérieurs et présente les analyses diagnostiques sur les sujets suivants concernant le Niger : (i) évaluation des risques climatiques ; (ii) identification de leurs impacts par secteur vulnérable ; (iii) évaluation des stratégies nationales de développement et la place du risque climatique, (iv) évaluation du paysage institutionnel nigérien afin d’identifier les parties prenantes nationales, leurs rôles et responsabilités, (v) identification des carences et des insuffisances, et (vi) recommandations à l’intention du PPCR pour favoriser l’intégration du risque climatique dans la planification des actions de développement au Niger. -
Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel : perspectives politiques
Ce document résume et rassemble les conclusions des analyses effectuées au long du projet. Il dégage les principaux enjeux pour les décideurs politiques, des pistes de travaux futurs, les lacunes et incertitudes des connaissances actuelles. Le climat du Sahel s’est toujours caractérisé par l’extrême variabilité saisonnière et décennale des précipitations. Cette dernière est probablement due à des interactions complexes entre plusieurs processus, aucun processus ne semblant pouvoir seul expliquer la variabilité observée. En dépit d’efforts considérables pour déterminer la cause de la longue et grave période de sécheresse qui a sévi à la fin du XXe siècle, la communauté scientifique n’est pas parvenue à un consensus. Ces incertitudes, ainsi que l’importance de la variabilité, rendent particulièrement difficiles les projections climatiques pour le Sahel et sont à l’origine d’importantes divergences entre les projections des différents modèles climatiques. -
Rapport de base sur les priorités et les objectifs nationaux en matière de changements climatiques et sur les initiatives de développement des capacités concernées
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident dans les observations de l’accroissement des températures moyennes mondiales de l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, et l’élévation du niveau moyen mondial de la mer. Cela est dû principalement à l’augmentation dans l’atmosphère des concentrations des gaz à effet de serre dues aux activités humaines : les augmentations du dioxyde de carbone sont principalement dues à l’utilisation des combustibles fossiles et au changement d’utilisation des terres, tandis que ceux du méthane et du protoxyde d’azote sont principalement dus à l’agriculture. -
Guide technique de l'élevage
Dans ce guide, sont identifiés les avantages et inconvénients des méthodes de conservation des terres agricoles applicables selon les conditions naturelles (dont notamment le relief, la nature du sol et les caractéristiques d'écoulement). Le guide inclut également une marche à suivre pour l'application de ces méthodes, ainsi que des exemples concrets. -
Atelier préparatoire pays à la tenue de DESERTIF' ACTIONS 2022
Pour lutter contre la dégradation des sols et des terres, les émissions de Gaz à Effet de Serre et l'insécurité alimentaire, une transition vers des systèmes alimentaires plus durables et inclusifs s’impose. Dans ce contexte, l'agroécologie offre une approche intégrée qui applique simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Ainsi, Désertif’actions 2022 se donne pour ambition de mettre l’agroécologie au cœur de l’agenda de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, en partageant et mettant en commun les résultats des actions menées par la société civile et la recherche. -
Impact des changements climatiques sur la dynamique de l'habitat potentiel de Balanites aegyptiaca (L.) Del. au Niger
La présente étude a pour objectif de modéliser la distribution potentielle de Balanites aegyptiaca sous l’influence des changements climatiques au Niger. Le principe d’entropie maximale (MaxEnt) a été utilisé pour déterminer les habitats favorables de l’espèce en fonction des variations des conditions climatiques actuelles et futures (horizon 2050). Les données de présence de l’espèce combinées aux données bioclimatiques dérivées de la base de données Worldclim ont permis de générer trois modèles climatiques pour les projections futures (les modèles CCCMA, CSIRO et HadCM3) sous le scénario A2 du GIEC. Les précipitations du trimestre le plus froid (BIO19) et les précipitations de la période la plus humide (BIO13) sont les variables environnementales qui ont plus contribué à la prédiction du modèle. Sous les conditions climatiques actuelles, 67,7% du territoire nigérien est très favorable au développement de Balanites aegyptiaca. Les modèles CCCMA et HadCM3 qui prédisent une augmentation des précipitations à l’horizon 2050 tout comme le modèle CSIRO qui prédit une diminution pour ce même horizon montrent que les habitats très favorables seront convertis en habitats moyennement favorables. -
Pratiques de pêche de poissons et changement climatique sur le fleuve Niger à Niamey, Niger
À Niamey, la pêche occupe une place historique dans l’économie de la ville, l’équilibre alimentaire et nutritionnel des populations à travers l’apport substantiel en protéines animales des poissons. La pêche se pratique sur le fleuve Niger dans les bassins de pêche de Goudel, Gamkallé et Néni Goungou. Elle est affectée aujourd’hui par des aléas climatiques en particulier les fortes chaleurs, l’étiage précoce, l’ensablement, etc. Depuis quelques décennies, les quantités de poissons pêchés ont fortement baissé. Cet article cherche à caractériser les pratiques de la pêche, les changements qui affectent ces pratiques et d’évaluer leurs effets sur les communautés de pêcheurs de Niamey. La méthodologie utilisée dans cette étude combine quantités de poissons pêchés, données hydrologiques du fleuve, climat (température et pluie) et données d’entretiens collectées auprès des pêcheurs, des mareyeuses et les agents de la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture (DPA) et professionnels du secteur de l’aquaculture au travers de l’utilisation des logiciels Sphinx Plus et Xlstat. -
Diversité interspécifique d'efficience d'utilisation de l'eau des acacias sahéliens et australiens
Depuis la fin des années 1960, la région sahélienne est gravement affectée par une répétition de déficits pluviométriques, avec des précipitations sensiblement en dessous des normales des 30 dernières années (Hulme 1996 ; LeBarb et Lebel 1997 ; Lebel et al. 2003 ; Nicholson 1979). De son coté, l'Australie est considérée comme l'une des masses continentales les plus arides au monde. Sa partie méridionale est soumise depuis une décennie " un déficit de pluviométrie historique. Par ailleurs, depuis deux millions d'années le climat australien tend progressivement vers un climat aride (Kershaw et al. 2003). Dans les deux cas, ces déficits pluviométriques répétés ont des conséquences néfastes. Dans le cas du Sahel, ils affectent des populations pauvres fortement dépendantes de l’agriculture. En outre la végétation ligneuse des zones sahéliennes fait l'objet d’une surexploitation chronique : le bois est utilisé comme source d'énergie et représente jusqu’à 90 + des sources d'énergies totales utilises (Hall et al. 1993). -
Évaluation sur l'impact de l'initiative pour le Renforcement de Résilience au Sahel (RISE) : Rapport d’enquête de suivie récurrent de 2018-2019
Les objectifs de ce rapport sont (1) de comprendre la gravité et l'évolution des chocs subis par les ménages au cours de la période du RMS ; (2) de documenter les stratégies d'adaptation qu'ils ont utilisées pour y faire face ; (3) d’évaluer leur résistance aux chocs ; et (4) d’explorer comment les capacités de résilience des ménages et le programme RISE à ce jour ont affecté leur résilience. Bien que la résilience elle-même soit une capacité à gérer ou à se remettre des chocs, les capacités de résilience sont un ensemble de conditions, d'attributs ou de compétences qui permettent aux ménages d'atteindre la résilience. -
Stratégie régionale climat (SRC) de la CEDEAO : version courte
Représentant actuellement seulement 1,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)1, les pays de l’espace CEDEAO contribuent de façon très faible au réchauffement climatique. Pour autant, le continent africain se situe au cœur des enjeux des changements climatiques de cette première moitié du 21ème siècle. Selon les scenarios les plus pessimistes, l’Afrique de l’Ouest connaîtra, d’ici à 2060, une augmentation de température de +2,3°C, soit un réchauffement de +0,6°C par décennie. Les précipitations seront quant à elles, plus erratiques et entraineront un accroissement de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques extrêmes déjà connus dans notre région : inondations, variabilité pluviométrique accrue, érosion côtière et des sols dans les bassins fluviaux, poches de sécheresse extrêmement longues, entre autres corollaires, avec des conséquences humaines et économiques dramatiques sur l’ensemble des secteurs économiques et sur les populations les plus vulnérables, dont notamment les femmes, les jeunes et les personnes âgées. -
Stratégie Régionale Climat (SRC) de la CEDEAO et Plan d’actions (2022-2030)
Représentant actuellement seulement 1,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)2, les pays de l’espace CEDEAO contribuent de façon très faible au réchauffement climatique. Pour autant, le continent africain se situe au cœur des enjeux des changements climatiques de cette première moitié du 21ème siècle. Selon les scenarios les plus pessimistes, l’Afrique de l’Ouest connaîtra, d’ici à 2060, une augmentation de température de +2,3°C, soit un réchauffement de +0,6°C par décennie. Les précipitations seront quant à elles, plus erratiques et entraineront un accroissement de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques extrêmes déjà connus dans notre région : inondations, variabilité pluviométrique accrue, érosion côtière et des sols dans les bassins fluviaux, poches de sécheresse extrêmement longues, entre autres corollaires , avec des conséquences humaines et économiques dramatiques sur l'ensemble des secteurs économiques et sur les populations les plus vulnérables, dont notamment les femmes, les jeunes et les personnes âgées. -
Plan de mise en œuvre du cadre national pour les services climatologiques du Niger
Le climat de notre planète change, et ses conséquences auront un impact significatif sur notre environnement et nos modes de vie à moyen et long terme. Il est donc important de changer notre mode de vie notamment à travers une meilleure exploitation de nos atouts pour faire face aux phénomènes météorologiques de plus en plus fluctuants et dangereux. La 3ème Conférence Mondiale sur le Climat qui s’est tenue à Genève en septembre 2009 a lancé le concept de services climatiques en le mettant pour la première fois sur l’agenda des discussions internationales sur le climat. Le terme de services climatiques recouvre de l’information sur le changement climatique et ses effets, la fourniture de données de sorties de modèles climatiques et la conception de produits plus élaborés répondant à une demande sectorielle ou individuelle, etc. Un Cadre mondial a été créé en vue d’organiser efficacement l’acheminement de l’information climatique à tous ceux qui en ont besoin. Il permettra aux producteurs, ainsi qu’aux chercheurs et utilisateurs de collaborer et d’accroître la qualité et le volume de services climatologiques disponibles dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Ce document décrit le plan de mise en œuvre de la composante nationale de ce cadre dénommé Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC) du Niger. -
Plan national d'adaptation aux changements climatiques
Les impacts des changements climatiques sont observés au niveau mondial, régional, national et local et appellent à une action collective. Pour le Niger, pays en développement, et très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques, la mise en œuvre des actions d’adaptation y compris le renforcement de la coopération internationale s’avère nécessaire. Ainsi, le Gouvernement du Niger s’est engagé dans plusieurs initiatives à travers le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD), organe multisectoriel qui coordonne la mise en œuvre des politiques liées au climat. Depuis 2014, la préparation du Plan National d’Adaptation (PNA) aux changements climatiques a été lancée afin de promouvoir, à moyen et à long termes, l’intégration de l’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) dans les politiques et stratégies de développement du pays afin de réduire la vulnérabilité des secteurs de développement et de renforcer leur résilience. -
Impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa
Cette présente étude porte sur les impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa. Les effets de la crise sécuritaire constituent de véritables drames pour les populations en générale et les producteurs en particulier. Les dégâts et les dommages qu’elles génèrent sont considérables sur l’économie de la région. L’objectif global de l’étude est de montrer les impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa. Les outils méthodologiques utilisés sont constitués de la recherche documentaire, de l’observation directe du terrain, de la collecte des données à travers des enquêtes quantitative et qualitative et enfin du traitement et analyse des données recueillies. Les résultats obtenus montrent que la crise sécuritaire et les récurrentes inondations ont eu des impacts négatifs sur la filière poivron dans la commune urbaine de Diffa. Tout d’abord, 45% des producteurs enquêtés ont arrêté la production du poivron à cause de l’insécurité Boko Haram et 32% ont abandonné leurs terres de production à cause des inondations répétitives. -
Analyse des risques climatiques pour l’identification et la pondération des stratégies d’adaptation dans le secteur agricole du Niger
Actuellement, les informations disponibles sur les risques climatiques et leurs impacts concernant le secteur agricole du pays sont limitées. Cette étude a donc pour objectif de fournir une analyse approfondie des risques climatiques accompagnée d’une vaste évaluation de quatre stratégies d’adaptation potentielles pouvant guider les décideurs locaux en matière de planification et de mise en œuvre de l’adaptation au Niger : (1) l’agroforesterie et la régénération naturelle assistée (RNA) des arbres gérée par les fermiers, (2) la gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS), (3) l’irrigation et (4) la gestion améliorée du fourrage pour le bétail. L’évaluation des impacts repose sur : des projections climatiques basées sur deux scénarios d’émissions (SSP3-RCP7.0 et SSP1-RCP2.6), une modélisation hydrologique des variations de la disponibilité en eau, la modélisation et la comparaison des rendements futurs de quatre cultures dominantes (le sorgho, le millet, le maïs et le niébé), ainsi qu’une évaluation de la production animale dans les conditions climatiques à venir. -
Stratégie de Communication de la PNSP/CCASAN au Niger
De manière spécifique, la PNSP/CCSAN vise à instaurer un dialogue permanent et participatif entre les décideurs, les utilisateurs, les OSC et les scientifiques/chercheurs pour l’application des résultats de la recherche sur les changements climatiques, l’Agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; à orienter le Gouvernement dans la prise de décision en matière d’agriculture intelligente face au climat; à développer la synergie entre les cadres de concertation existants dans le domaine des changements climatiques et à renforcer la synergie dans le cadre de la mise en œuvre des trois conventions de Rio et des Stratégies, Plans et Programmes de développement entre autres. -
Revue de la littérature sur l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) au Niger
L'agriculture intelligente face au climat (AIC) est une approche qui aide les personnes gérant les systèmes agricoles à faire face au changement climatique de manière efficace. L'approche de l'AIC vise trois objectifs, à savoir l'augmentation durable de la productivité et des revenus, l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, lorsque cela est possible. Cela ne signifie pas que chaque pratique appliquée au niveau de chaque endroit doit atteindre ce triple objectif. L'approche de l'AIC vise plutôt à minimiser les contreparties (corrélations négatives) et à promouvoir les synergies en tenant compte de ces objectifs pour éclairer les décisions du niveau local au niveau mondial, à court et à long terme, dans le but d'obtenir des solutions localement acceptables. Au Niger la mise en œuvre du PANA a été l’élément précurseur dans la pratique d’AIC puisqu’ayant permis déjà en 2006 d’identifier les options d’Adaptation. En effet l’arrivée du concept d’AIC a servi de tremplin pour démultiplier et vulgariser les options identifiées lors de l’élaboration du PANA. -
Changements climatiques : impacts, adaptation et atténuation au Niger
Cette étude analyse les généralités sur les changements climatiques, les manifestations dans le monde avec un accent particulier sur le milieu sahélien. Les impacts dans les secteurs socioéconomiques, les mesures d’adaptation et la gestion des risques sont analysés en détail en s’appuyant sur des questions locales (Niger). -
Fiches techniques relatives aux principales mesures d’adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation au Niger
Ce document est un recueil de fiches techniques relatives aux principales mesures d’adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation au Niger. Il fait partie intégrante du module de formation développé dans le cadre de la SPIN et intitulé "Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger" -
Guide du formateur pour le module de formation : Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger
Ce guide du formateur fait partie d'un module de formation qui a pour objectif de décliner des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique dans le contexte de la petite irrigation au Niger. -
Module de formation : Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger
Ce module de formation dont le développement a été financé par le PromAP/GIZ porte sur l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation. Ce document est articulé en 2 chapitres. Un premier chapitre qui retrace l’état des connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts et un deuxième chapitre qui expose les principales mesures d’adaptation de la Petite Irrigation aux Changements et à la variabilité Climatiques au Niger. -
Perceptions paysannes des aléas climatiques sur la production du riz sur le périmètre irrigué de Saga dans la Vallée du Fleuve Niger
L’objectif général poursuivi est d’analyser la perception des aléas climatiques auprès des exploitants en milieu urbain. Pour ce faire, des entretiens semi-structurés et des enquêtes ont été effectués. Au total 140 exploitants disponible ont été enquêtés. Un critère d’âge de sélection des exploitants variant de 15 à 50 ans a permis de s’assurer que les stratégies développées font suite à une perception effective des changements. L’analyse des données a été faite par le logiciel Access et Excel pour le calcul des paramètres statistiques descriptifs et la réalisation de graphiques. Ces derniers observent l’existence des paramètres climatiques qui interviennent dans leur pratique à 90%. Les résultats de la recherche révèlent que 66 % des exploitants ont un niveau d’instruction assez bas. Face aux aléas climatiques les exploitants mettent en œuvre des stratégies durables d’adaptations qui participent à l’amélioration des rendements. -
Partenariat scientifique REUNIR - PAM : Apport de la recherche pour un changement de paradigme dans l'opérationnalisation résilience au Sahel
Le présent ouvrage fait la synthèse d’une partie des travaux réalisés dans l’ensemble des 5 pays, l’objectif visé étant de partager les expériences de bonnes pratiques mises en œuvre au niveau de ces pays du sahel et les leçons apprises de leur mise en œuvre en termes de modalités techniques et partenariales. Des technologies innovantes et des bonnes pratiques ont ainsi été identifiées et mises en œuvre avec des résultats fort concluants. -
Les inondations au Niger 1998-2020
Au Niger, l'augmentation des inondations a été démontrée à l'échelle du pays par Fiorillo et al. (2018) analysant les données officielles collectées par le gouvernement sur les dommages de 1998 à 2017. Concernant les impacts régionaux et sous-régionaux des inondations, les zones Sud-Ouest du pays se sont révélées être les plus exposées aux risques d'inondation. Au cours des 20 dernières années, la littérature scientifique s'est principalement concentrée sur les changements de l'ampleur des inondations du fleuve Niger en essayant de comprendre à la fois les changements en cours dans les caractéristiques hydrologiques et les principaux facteurs déclenchant l'augmentation des inondations dans la région. Cependant, Tiepolo et al. (2016; 2018) ont démontré que le fleuve Niger n'est que une des causes du risque d'inondation, et que la plupart des évènements ne sont pas liés à une dynamique fluviale. -
Champ école agro-pastoral pour une agriculture intelligente face au climat
Ce document « Guide Pratique du facilitateur de Champ Ecole Agro-Pastoral pour une Agriculture Intelligente face au Climat » est un aide-mémoire pour les facilitateurs déjà formés à l’approche champ école qui reflète les innovations et évolutions actuelles des champs écoles au Niger. -
Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales et des écosystèmes aux changements climatiques dans les Etats du Liptako-Gourma Volume III Niger
Face aux effets induits aux populations (notamment socio-économiques) par les sécheresses des années 1972-73, des mesures ont été prises par les autorités en 1976. Ainsi, près de 70 000 ha de la réserve de faune de Tamou ont connu un déclassement partiel pour des besoins d’activités Agricoles.Pour ce faire, des populations en particulier celles du Zarmaganda (Ouallam, Filingué) ainsi que des agents publics (en vue de contribuer à la sécurité alimentaire) ont été réinstallées dans la zone déclassée. Même si la plupart des acteurs initiaux ont regagné leurs zones d’origine après quelques années de production, il reste qu’aujourd’hui, la zone d’Aïnoma reste soumise à une spéculation foncière remarquable (en partie du fait de la démobilisation de ces acteurs initiaux). Cette situation accroit les pressions sur ce qui reste de la réserve de Tamou, d’une superficie actuelle de 77 000 ha, servant plutôt de zone tampon pour le parc national W du Niger. Pour diminuer les pressions sur cette réserve, des actions de conservation ont été réalisées dont la principale entre dans le cadre du PAPE, composante Niger, en direction des zones périphériques du complexe WAP, mais qui apparait insuffisante pour sécuriser les formations naturelles autour de la réserve de Tamou. -
Étude Nationale sur le lien entre migration, environnement et changement climatique au Niger
Cette étude de base, vise à générer des données empiriques permettant de contribuer au renforcement des connaissances et des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à mieux gérer les questions relatives au nexus MECC mais aussi de permettre aux pouvoirs publics d'adopter des mesures précises pour fournir des solutions adéquates à ces communautés et renforcer leur résilience. -
Stratégies d’adaptation du Mil (Pennisetum glaucum [L.] R.Br) face à la variabilité et au changement climatique au Niger : Prise en compte des Perceptions communautaires et des techniques agronomiques dans la gestion des risques agroclimatiques.
L’objectif de ce travail est de rendre la culture du mil encore plus résiliente face au changement accentué du climat en liant les connaissances scientifiques aux perceptions communautaires. Pour cela, une enquête sur les risques agroclimatiques a été conduite sur 361 chefs de ménage de l’ouest du Niger et des techniques de transplantation et des coupes des feuilles des jeunes plants ont été testées au Centre Régional AGRHYMET. Les résultats des essais ont été évalués avec le Modèle SARRA_H par rapport au climat futur et auprès des paysans. Les résultats de l’enquête ont montré que les communautés sont conscientes des risques agroclimatiques, dont les plus fréquents et les plus sévères sont la fin précoce des pluies, les vents de sable en début de saison et les séquences sèches. -
Contribution Déterminée au niveau National
La Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Niger s’inscrit dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de l’Accord de Paris sur le climat. Elle s’aligne aux politiques et stratégies nationales, notamment la SDDCI Niger 2035, le PDES-2017-2021 ainsi que les programmes/projets de gestion durable des ressources naturelles et de l’accès aux services énergétiques modernes pour tous à l’horizon 2030. -
Inondabilité : une méthode de prévention raisonnable du risqe d'inondation pour une gestion mieux intégrée des bassins versants
Une partie de la réponse aux impacts économiques, sociaux et humains des inondations réside en une meilleure gestion de l'occupation des sols. La méthode inondabilité permet d'apporter une réponse opérationnelle aux acteurs en charge de la gestion et l'aménagement des cours d'eau. Elle permet de mesurer dans la même unité et de comparer les deux facteurs indépendants que sont l'aléa et la vulnérabilité, pour aboutir à une quantification objective du risque. Sa mise en oeuvre sur un bassin versant consiste en une modélisation de l'hydrologie grâce aux modèles Débit-durée-Fréquence, de l'hydraulique ainsi que de l'occupation du sol pour aboutir à une représentation cartographique du risque. -
Analyse de la réponse pour l’adaptation climatique
Le récent examen stratégique du Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l’objectif de Développement durable Faim Zéro désigne le changement climatique comme l’un des facteurs récents de la faim les plus complexes. Pour faire face à cette nouvelle menace pour la sécurité nutritionnelle à l’échelle globale, de nouvelles approches d’élaboration de programme sont nécessaires. Très souvent, les mécanismes de financements internationaux pour la lutte contre le changement climatique ne sont pas accessibles duaux critères spécifiques d’élaboration de programme requis pour accéder à lesdits fonds. -
Climate change, biodiversity and nutritions nexus : evidence and emergency policy and programming opportunities
This paper presents the findings of a desk review conducted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations that found that the majority of tools used to study climate change, biodiversity or nutrition focus on only one or two of these domains and very few explicitly address all three. The same goes for policies in the three sectors. It also identified numerous entry points to improve biodiversity and diets as the two levers to improve nutrition and optimize environmental sustainability. Based on these findings, the study makes a number of recommendations for action by governments, academia, civil society, the private sector and international organizations to address these shortcomings. -
Le changement climatique : une nouvelle ère sur la Terre
L'effet de serre est depuis quelques années sous les feux de la rampe. Ce phénomène climatique s'est imposé en peu de temps comme l'un des problèmes cruciaux du XXI em siècle, l'effet de serre n'est pas un , il n'y a rien de mystérieux. -
Lutte contre la désertification pour faire face aux changements climatiques
La désertification est définie comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches1. Elle est entraînée par divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Un tiers de la population humaine mondiale vit sur les terres arides qui représentent plus de 40 % de la surface des terres émergées de la planète. La désertification ne correspond pas à l’avancée du désert mais à une diminution progressive de la qualité des sols et un appauvrissement de la vie qu’il hébergent. Cette destruction des sols traduit une perte de leur fertilité et a donc des conséquences négatives sur l’environnement et sur les conditions de vie des populations. -
Réchauffement climatique : définition, explications
Le réchauffement climatique planétaire global et mondial correspond à la hausse de la température moyenne de l'atmosphère proche de la Terre et des océans depuis l'industrialisation des 150 dernières années. La tendance de dérèglement climatique calculée sur les 50 dernières années (1956 à 2005) est de 0,10 à 0,16 °C par décennie. -
Gaz à effet de serre : définition, explications
Un gaz à effet de serre regroupe des composés gazeux atmosphériques capables d'absorber le rayonnement infrarouge tellurique et thermique. Les gaz à effet de serre, abrégés en GES, affectent le rayonnement de substances gazeuses dans l'air : les GES ont à la fois une origine naturelle et une origine anthropique. Les gaz à effet de serre sont constitués de vapeur d'eau H2O pour 54 %, dioxyde de carbone CO2 (gaz carbonique) pour 39 %, l'ozone O3 pour 2 %, l'oxyde d'azote N2O pour 2 %, le méthane CH4 pour 2 %, CFC, etc. Ils contribuent à la régulation du climat à la surface de la Terre. Les conséquences sont multiples mais la concentration des principaux gaz à effet de serre a continué d'augmenter dans l'atmosphère pour atteindre un record à fin 2012. -
Technologies agricoles climato-intelligentes pour le Sahel et la Corne de l'Afrique de l'Afrique
Ce catalogue décrit une série de solutions agricoles pour les zones arides du Sahel et de la Corne de l'Afrique, utiles pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Il est basé sur les interventions du programme Technologies pour la transformation de l'Agriculture en Afrique (TAAT). Ce programme, dirigé par l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA),est à l'origine de nouvelles approches pour le déploiement de technologies éprouvées auprès des agriculteurs africains. TAAT est né d'un effort commun de l'IITA et de la Banque Africaine de Développement (BAD) et constitue un élément important de la stratégie « Nourrir l'Afrique » de cette dernière. TAAT fait actuellement progresser plus de 76 technologies à travers 88 interventions dans 28 pays, dont neuf pays de la zone agro-écologique sahélienne: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan du Sud, Tchad et Éthiopie. -
Caractérisation climatique de la région de Tillabéri
Le Niger est un Pays sahélien et enclavé, dont le point le plus proche de la mer se trouve à environ 600 km.lil couvre une superficie de 1.267.000 km2 et se situe entre les longitudes 0° 16’ et 16° Est, et les latitudes 11°1’ et 23°17’ Nord. Les 3/4 du pays sont occupés par des déserts dont celui du Ténéré qui compte parmi les déserts les plus célèbres du monde. Le climat du pays est de type tropical aride et semi aride. Le Niger se situe en effet dans l’une des zones les plus chaudes du globe. Il est caractérisé par quatre types de saisons : Une saison dite froide (mi-décembre à mi-février) Une saison sèche et chaude (mars-mai). Une saison de pluie (juin-septembre) Une saison chaude sans pluie (octobre à mi-décembre -
Programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS) Résumé des résultats des enquêtes de base niveau ménage : site de Fakara, Niger
Ce rapport présente les résultats des enquêtes de base conduites au niveau des ménages de sept (7) villages du site de Fakara (Niger) dans le cadre du programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité alimentaire. L’objectif de ces enquêtes était de de collecter toutes les données et informations sur des indicateurs clés de base concernant les ménages notamment les moyens de subsistance, l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, les besoins d’information sur le climat et la gestion des risques, et les pratiques d’atténuation et d’adaptation. La population du site pratique l’Islam et est majoritairement active (âge compris entre 5-60 ans). Cependant on observe un faible niveau d’éducation avec environ 58% des ménages ayant un membre avec un niveau primaire. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques de production. La majorité des ménages a accès à au moins 1ha de terre. Les intrants agricoles sont très peu utilisés, essentiellement des engrais. L’agriculture est diversifiée et constitue la source majeure pour la satisfaction des besoins alimentaires des membres des ménages. L’essentiel de la production est destinée à l’autoconsommation, avec un faible pourcentage de produits agricoles et animaux vendus. -
Plan villageois de réduction du risque d’inondation et de sécheresse dans la commune d’Ouro Gueladjo au Niger
Le Niger se trouve actuellement dans une situation de forte vulnérabilité face aux changements et aux risques climatiques. En effet, l’environnement peu favorable qui le caractérise a imposé aux communautés de développer des systèmes de production agricole capables de minimiser les risques conséquents aux aléas climatiques. Les paysans ont accumulé un capital important de connaissances et de stratégies d’adaptation et de gestion des risques pour assurer leur subsistance. Cependant, la plupart de ces stratégies d’adaptation, face au présent changement climatique (CC) et aux impacts conséquents, n’est pas tout à fait adéquate et expose les paysans à des choix qui peuvent impliquer des risques accrus (World Bank 2008). En plus, le CC est en train d’affecter le cycle de l’eau et le processus des crues tant en multipliant les crues soudaines que, dans certaines régions, les crues fluviales (IPCC 2012). -
Association de cultures Acacia senegal - céréales : outil de résilience aux changements climatiques au Niger
La présente étude aborde le diagnostic de l’association cultures/Acacia senegal dans l’ouest du Niger. Elle vise comme objectifs de : (i) déterminer la taille des exploitations agricoles ; (ii) apprécier le rendement des principales cultures en association avec A. senegal ; (iii) analyser les perceptions des paysans de l’association mil/A. senegal dans les exploitations agricoles. Elle a été conduite à travers une enquête semi-structurée dans les localités de Kokoyé (Tera) et Kiki (Makalondi). Il ressort de l’analyse des données collectées que quatre (4) systèmes de cultures sont pratiquées dans les exploitations à savoir la culture pure, la culture associée sans A. senegal, la culture associée avec A. senegal et la jachère avec une superficie moyenne par exploitation respectivement de 1,69 ± 1,77 ha; 5,94 ± 5,25 ha, 3,43 ± 3,10 ha et 1,87 ± 1,48 ha. Le mil, le sorgho, le niébé et le sésame sont les principales spéculations cultivées en association avec A. senegal (37,04 %) avec une superficie moyenne respectivement de 4,56 ± 3,87 ha, 3,02 ± 3,02 ha, 5,05 ± 4,86 ha et 2,99 ± 3,04 ha et une production moyenne respectivement de 588 kg/ha; 702 kg/ha; 24,62 kg/ha et 195,4 kg/ha. Le faible rendement est observé dans la localité de Kokoyé pour toutes les spéculations malgré qu’elle possède la plus grande taille d’exploitation agricole. Cette pratique d’association cultures/A. senegal pourrait être une alternative de substitution des fertilisants minéraux qui sont de plus en plus inaccessible aux ménages pauvres. Mots clés: Association ; Culture ; Acacia senegal ; Production. -
PAIS-Plan d'Adaptation aux Inondations et à la Sécheresse Villages administratifs de Garbey Kourou et Tallé, Commune de Gothèye, Niger
Le Diagnostic des risques d’inondation et de sécheresse dans les villages administratifs de Garbey Kourou et de Tallé, Commune de Gothèye (Braccio et al. 2015) a identifié l’inondation pluviale comme risque principal à Garbey Kourou et le risque sécheresse en premier place à Tallé étant le risque débordement de la rivière est moins important. Bien que les récepteurs exposés soient bien plus importants en zone de débordement de la rivière Sirba, l’haute probabilité d’une pluie intense en 2015 amène en première place le risque inondation pluviale à Garbey Kourou. L’étendue des cultures exposées à la sécheresse et le 13% de probabilité d’avoir une séquence sèche en 2015 amène en la deuxième place le risque sécheresse (en première place à Tallé). Enfin la moyenne probabilité (2%) d’avoir un débordement catastrophique en 2015 place ce risque en dernière place. -
Evaluation des risques multi-aléa dans les communes de la Région de Dosso au Niger, 2011-2016
Entre 2010 et 2016, en Afrique de l’Ouest, 715 projets d’adaptation et de resilience au changement climatique (CC) ont été financés par l’aide au développement (OECD). Cependant, la connaissance du risque n’est pas avancée dans la même mesure. L’analyse du risque a été développée sur certaines grandes villes, bassins fluviaux ou régions mais rarement à l’échelle municipale. L'accent est mis sur le risque d’inondation, malgré le Cadre de Sendai et les ODD (2015) recommandant une vision globale des risques. Pourtant, la connaissance du niveau de risque serait utile pour les projets locaux et les politiques visant la résilience et l’adaptation au CC. Les cartes du risque pour les zones d’intervention des projets pourraient permettre d’adresser les actions où le risque est plus élevé. La variation du niveau de risque au fil du temps aiderait à évaluer les impacts des plans et des projets. -
Diagnostic des risques d'inondation et de sécheresse dans les villages administratifs de Garbey Kourou et de Tallé, Commune de Gotheye, Niger
Le diagnostic des risque inondation et sécheresse dans les villages administratifs de Garbey Kourou et Tallé, Commune de Gothèye (Niger) succédant à l’analyse du risque à l’échelle communale conduite par le Projet Anadia-Niger dans la région Tillabéri. Un diagnostic similaire à été développée pour quatre villages de la commune d’Ouro Gueladjio et pour celle de Imanan. Le diagnostic a été développé par une équipe mixte italo-nigérienne composé par fonctionnaires de la commune de Gothèye, de la DMN, chercheurs de l’Ibimet-CNR et du DIST-Politecnico et Université de Turin avec la participation des agriculteurs des deux villages. Garbey Kourou et Tallé sont deux gros villages de la commune (4.600 et 2.600 habitants en 2012) étalées sur la rive gauche de la rivière Sirba prés de sa confluence avec le fleuve Niger. Les deux villages sont ainsi exposés au débordement de la rivière, à inondation pluviale et à sécheresse. -
Farmers’ Perceptions about Climate Change and their Adaptation Strategies: a case Study in the Fakara Region of Niger
Information about farmers’ perceptions of climate change and their adaptation strategies is needed for developing regional climate change adaptation plans for rural areas. This study was conducted in rural communities in the semi-arid Fakara region of Niger. The objectives were to identify the major effects of climate change and their impacts on the rural communities, adaptation strategies of the rural communities, and difficulties in using natural signs to predict the onset of the rainy season. Data were collected using participatory research tools. Farmers stated that the climate is becoming hotter and drier, and with more variability in rainfall. The major effects of climate change were drought, strong winds and floods. The major impacts were higher mortality of crop plants, insufficient pasture plants, increased parasites, eroded and crusted soils, destruction of habitat, and loss of livestock. -
Changement climatique
Un atelier de lancement du Projet a été organisé le 02 Septembre 1998 dans les locaux du Centre Culturel Oumarou Ganda (CCOG) de Niamey, sous la supervision teclmique de Monsieur Souleymane Diallo ,Coordonnateur Régional des Projets Changements Climatiques, PNUDIFEM , Dakar. L'objectif essentiel visé par cet atelier était de sensibiliser et d'informer les partenaires sur les principaux objectifs et enjeux de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques(CCNUCC) et du Projet en vue d'assurer une participation effective de tous les concernés dans la mise en œuvre de la Convention au plan national en général et du Projet en particulier. Les points clés de certains exposés, le programme de travail de l'atelier, les discours prononcés ainsi que la liste des participants qui ont pris part à l'atelier sont présentés en annexe. -
Villages Climato-Intelligents - Une approche de l’AR4D pour la mise à l’échelle de l’agriculture intelligente face au climat
Afin de satisfaire le besoin d’options avérées et efficaces d’AIC, le programme de recherche pour le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS) a élaboré l’approche du village intelligent face au climat (CSV) comme moyen pour la recherche agricole pour le développement (AR4D) dans le contexte des changements climatiques. Cette approche vise à combler les déficits de connaissances et stimuler la mise à échelle de l’AIC. L’approche du CSV repose sur les principes de la recherche action participative afin de fonder la recherche sur des conditions appropriées et spécifiques au site/contexte, de produire des preuves plus importantes de l’efficacité de l’AIC dans un milieu de vie réel et de faciliter l’élaboration conjointe de mécanismes de mise à échelle pour des terroirs et aux niveaux infranational et national. -
Participation du Ministère de l'Agriculture à la COP21 à Paris (France) du 30 novembre au 12 décembre 2015
La convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCCI), adopté en 1992 à Rio de Janeiro, a instituer en son article 7, une conférence des parties appélée COP, sigle de terminologie anglaise (conference of parties) -
Risques pluviométriques, source d’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger
Au cours des dernières décennies, le Niger a subi des nombreux aléas climatiques qui ont pour conséquences une diminution de la production agricole et une recrudescence des crises alimentaires et nutritionnelles. L’objectif de cette étude, vise à analyser le lien entre l'insécurité alimentaire nutritionnelle et les risques pluviométriques. La méthodologie utilisée est surtout basée sur des enquêtes (entretiens en groupe et entretiens individuels) dont les populations cibles sont celles des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri. Les résultats relèvent qu’il existe une différence significative entre les précipitations des trois régions. Les résultats, ont aussi, montré que les deux risques pluviométriques sont : les sécheresses et les inondations. Mais, au vu de la population rurale, les sécheresses impactent beaucoup négativement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle car elles engendrent une diminution de la production céréalière et une augmentation des prix des céréales locaux. La sécheresse contribue fortement au déterminisme de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger -
Effets des changements climatiques sur les pratiques d’élevage et analyse des options d’adaptation : Cas de la zone de Bouza-Niger
Une étude sur l’effet de changement climatique sur pratiques d’élevage a été menée au département de Bouza (Tahoua) afin de mieux analyser les options d’adaptations. Soixante (60) éleveurs ont été choisis de façon systématique dont vingt (20) à Bouza et vingt (20) dans deux zones proches de Bouza. Les impacts socioéconomiques et environnementaux liés aux changements climatiques et les stratégies d’adaptation du système de productions animales pratiquées par les éleveurs ont été recherchés. La quasi-totalité de la population (90%) enquêtée affirme, par leur vécu, que les saisons de pluies sont de plus en plus sèches au cours de vingt (20) dernières années. Les réactions des différents acteurs relatifs à la modification des précipitations ont permis d’identifier trois principaux risques climatiques dont la sécheresse, les pluies tardives et les inondations. Les impacts sur le système de production et les ressources alimentaires sont entre autres, la réduction des parcours, une diminution des espèces les plus appétées, une augmentation de la profondeur des puits et puisard, une réduction de la durée de lactation, et une baisse de la productivité numérique. Il a été remarqué quatre (4) principaux risques climatiques à savoir la baisse du cumul pluviométrique, le raccourcissement de la longueur de la saison humide, la hausse des températures et la fréquence des inondations. Les options d’adaptation concernent surtout la valorisation des cultures fourragères (collecte et stockage du fourrage) et l’aménagement des points d’eau. La perception des éleveurs a permis de relever les impacts climatiques, les risques associés ainsi que les stratégies d’adaptation à entreprendre. -
Un modèle empirique d’intégration de stratégies de gestion de risques climatiques pour une résilience genre-sensible en zone sahélienne - Document de capitalisation de l’Initiative GARIC : « Genre, agriculture et gestion des risques climatiques
L’intégration de stratégies d’adaptation multiples est aujourd’hui nécessaire pour renforcer la résilience des producteurs ruraux sahéliens, confrontés à des risques climatiques importants. La présente étude fait ressortir, à travers l’analyse du processus de trois années du projet « Genre, Agriculture et gestion des Risques Climatiques » (GARIC, CARE International au Niger), une démarche empirique intéressante, conduite pour accroitre la résilience des producteurs ruraux les plus vulnérables dans la région de Maradi, Niger. L’analyse de ce processus a permis de proposer un modèle intégré de gestion des risques climatiques incluant quatre composantes stratégiques complémentaires : i) Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés ; ii) Développement des services agro-économiques de proximité & des activités régénératrices de revenus ; iii) Développement et utilisation des techniques agroécologiques permettant de mieux gérer les risques climatiques et écologiques ; et iv) Implémentation cohérente des approches de planification locale comme la planification saisonnière participative et les systèmes d’alerte précoce. C’est une expérience co-construite, qui a impliqué les paysans (en particulier les groupements de femmes Mata Masu Dubara), les structures administratives (communes, autorités locales, conseil régional) ainsi que partenaires techniques et scientifiques jouant chacun un rôle spécifique (notamment les services techniques publics et l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi). -
Impact du climat et des activités anthropiques sur les écosystèmes dans le nord-ouest de la région de Tillabéri au Niger
Les communes de Tondikiwindi et de Ouallam, appartiennent au département de Ouallam, région de Tillabéri, nord-ouest du Niger. Cette zone, comme le reste du sahel, a été le théâtre d’importantes variabilités climatiques et d’autres aléas liés au climat, depuis la décennie 1970. L’objectif principal de cette thèse est de contribuer à une meilleure connaissance des impacts du climat, conjugués aux activités anthropiques sur les différentes unités de l’occupation des sols dans les communes de Tondikiwindi et Ouallam. L’analyse de certains paramètres hydro-climatiques (pluviométrie, températures, séquences sèches, Etp, vents), de la station synoptique de Tillabéry et des stations pluviométriques proches de celle-ci et des données des enquêtes menées auprès des populations ont permis d’aboutir à des résultats intéressants et de proposer une stratégie de développement durable, permettant d’inverser les tendances. -
Développement local, institutions et changement climatique au Niger - Analyse de la situation et recommandations opérationnelles
Ce document fait partie d’une série d’études commissionnées par le Département du Développement Social de la Banque mondiale, dans le cadre du projet ‘Institutions locales et changement climatique’ (Area Based Development and Climate Change/ABDCC), mis en oeuvre grâce au soutien du Programme de Partenariat Pays Bas-Banque Mondiale (BNPP) et le Fond Norvégien et Finlandais pour un développement social et environnemental durable (TFESSD). L’objectif de base du projet est de comprendre comment les initiatives de développement local peuvent améliorer la capacité d’adaptation et la résistance des acteurs et des groupes communautaires locaux face au changement climatique. -
Les implications du changement climatique pour le développement agricole et la conservation des ressources naturelles en Afrique
En Afrique, l'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique en raison de sa saisonnalité, le manque de résilience des paysans aux catastrophes, la présence de stresseurs non-climatiques importants qui influencent la sensibilité au changement de conditions climatiques, et la pauvreté endémique. Le présent article examine les répercussions du changement climatique pour la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles en Afrique. Il représente des des informations sur l’état actuel des connaissances sur la vulnérabilité, l'impact et l'adaptation de l'agriculture africaine et des ressources naturelles au changement climatique. -
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture : Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire
En adoptant les objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et dans l’Accord de Paris sur le changement climatique, la communauté internationale a pris l’engagement de construire un avenir durable. Cependant, pour éliminer la faim et la pauvreté d’ici à 2030 tout en s’attaquant à la menace que constitue le changement climatique, une transformation profonde des systèmes alimentaires et agricoles sera nécessaire partout dans le monde. -
Analyse environnementale et changement climatique dans trois communes d'intervention du PAM au Niger - Rapport global de l’analyse climatique, des services climatiques et des interventions du PAM dans les sites de Karkara, Sahiya, Darey et Toungfini (Niger)
La présente note fait état de l’évolution récente du climat dans la région ouest du Niger et en particulier Darey, Allakaye, Tondikiwindi et Bagaroua, quatre villages suivis par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Il est attendu sur ces villages de mieux comprendre la variabilité du climat, la perception qu’en ont les populations villageoises et comment elles définissent des stratégies pour s’y adapter. On documente ici deux variables climatiques, la précipitation et la température qui jouent un rôle majeur dans la productivité agricole au Sahel. Les pluies conditionnent le contenu en eau des sols. Un déficit de pluie et/ou un excès de température prolongés peut donc être très préjudiciable pour les rendements. A contrario un excès brutal de précipitations sous l’effet d’orages trop intenses ou des températures maximales trop fortes au-delà des limites physiologiques de résistance des plantes peut conduire à la destruction irréversible des cultures. Ces variables climatiques sont très directement liées aux conditions atmosphériques régionales. Elles subissent donc une forte variabilité liée au fonctionnement intrinsèque de la mousson d’Afrique de l’Ouest, lui-même pouvant être influencé par les conditions atmosphériques globales. Ces variables ont évolué par le passé et continueront d’évoluer dans le futur. -
Évaluation des besoins en technologies d’adaptation aux changements climatiques pour les secteurs de l’agriculture et des ressources en eau
Pays enclavé du Sahel Ouest Africain dont le port le plus proche se situe à plus de 1000 km, le Niger s’étend entre la longitude 0°16' et 16° Est, et la latitude 11°1' et 23°17' Nord sur une superficie de 1 267 000 km² dont les trois quarts (3/4) sont désertiques. Il est limité au Nord par l’Algérie et la Libye, au Sud par le Bénin et le Nigeria, à l’Est par le Tchad et à l’Ouest par le Burkina Faso et le Mali. Pour le climat, il est de type tropical sec avec une longue saison sèche de 7 à 9 mois et une courte saison de pluies de 3 à 5 mois sous l’influence de la mousson, masse d’air équatorial humide et de l’harmattan, une masse d’air tropical sec avec son vent desséchant. -
La résilience des ménages face aux changements climatiques dans la région de Maradi au Niger : le cas de la Régénération Naturelle Assistée.
Face à une dégradation de l’environnement et à l’accroissement des chocs conjoncturels et structurels dans la région de Maradi, la population de la zone a développé des stratégies afin de lutter contre les risques de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et la pauvreté. En effet, les nombreuses crises climatiques et alimentaires ont induit le développement de stratégies extrêmes de la population telles que la coupe abusive du couvert ligneux. Or, ces coupes ont fragilisé un environnement sahélien aux ressources souvent limitées. Toutefois, de nombreuses mesures ont été mises en place afin d’accroitre la résilience environnementale des populations. En effet, depuis 1980, le Fond International de Développement Agricole (FIDA) a introduit la Régénération Naturelle Assistée (RNA) dans la zone de Maradi. Celle-ci est une méthode d’agroforesterie participative valorisant les rejets d’arbustes ligneux endogènes permettant une reconstitution du couvert ligneux des parcelles agricoles. La RNA a induit depuis 30 ans un effet inverse permettant d’améliorer l’environnement, le couvert ligneux (fertilité des sols, protection contre le vent, ombrage) mais aussi les revenus et conditions de vie des ménages. -
Guide de la CEDEAO sur l’Accord de Paris en vue de son application par ses Etats membres
La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) publie un guide sur l’application de l’Accord de Paris sur le climat à destination des Etats d’Afrique de l’Ouest et, plus généralement, des pays en développement. Développé avec l’appui du projet régional GCCA+ Afrique de l’Ouest, financé par l’Union européenne, ce guide a pour objectif d’aider les pays en développement à respecter leurs obligations à partir d’une bonne compréhension du sens et de la portée des dispositions de l’Accord de Paris, conclu en 2015. Le guide est construit autour de fiches d’information, d’orientation et d’action classées par thématiques : atténuation, adaptation, mise au point et transfert de technologies, renforcement des capacités, transparence de l’action et de l’appui nécessaire et reçu. Chaque fiche comporte une brève mise en contexte (définition et enjeux), les éléments de réponse apportés par l’Accord de Paris pour répondre à l’enjeu, un récapitulatif des obligations et de leur portée (obligation de résultat, obligation de moyen, option facultative), ainsi qu’un rappel du calendrier pour s’y conformer, et ce, du point de vue des Etats membres de la CEDEAO et du CILSS. Des recommandations pour la mise en œuvre sont également suggérées pour guider l’action des gouvernements. -
Rapport de mission Participation du Ministère de l'Agriculture à la 19éme Conférence des Parties sur le changement climatique A Varsovie (Pologne)
Du 8 au 23 novembre 2013, un cadre de la Direction des Etudes et de la Programmation, représentant le Ministère de l'Agriculture dans la délégation nigérienne, a effectué une mission de travail à Varsovie en Pologne, à l'effet de prendre part à la 19ème Conférence des Parties sur le changement climatique. -
Rapport de mission : participation du Ministère de l'agriculture à la COP21 à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015
Cet organe, ouvert à la participation de toutes les parties, est composé des représentants du gouvernements, experts dans le domaine du changement climatique -
Renforcer la résilience face aux changements climatiques : la voie à suivre pour répondre aux effets des événements climatiques extrêmes sur l'agriculture
Au cours des dernières décennies, le nombre de catastrophes à l'échelle mondiale a eu tendance à augmenter, entrainant la croissance des impacts économiques associés. -
Adaptation aux changements climatiques
L’homme s’est aventuré depuis plusieurs siècles comme seul maître de la planète, oubliant dans ses démarches, l’équilibre et l’interaction écologique. En effet comme le dit un adage : « Notre ignorance est une indifférence et notre indifférence est un crime ».C’est pourquoi depuis quelques décennies, le Changement climatique représente des menaces sérieuses aux vies, aux moyens d’existence puis accentue la précarité et le sous-développement. Il est marqué par des variations des températures inhabituelles qui affectent de différentes façons les systèmes de production. -
Etude d'avant projet détaille et élaboration du dossier d'appel d'offres dans les régions de maradi,tahoua et zinder volume du programme prioritaire
Suite à une procédure de pré-qualification,la direction générale du génie rural relevant du ministère de l'agriculture du niger,représentée par le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de maradi,tahoua et zinder (PMERZA-MTZ,désigne ci-aprés par "client"), a invité , le 07/02/2012, studi international à lui soumettre une proposition technique et financière pour "Etude d'Avant-projet détaille (ADP) et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) dans les régions de la maradi,tahoua et zin der -
Impacts des changements climatiques sur les forêts au Niger
L’étude porte sur l’évaluation approfondie des risques de changement sur les forêts et mise en place d’un ensemble d’outils d’analyse et de planification à long terme pour gérer les incertitudes du développement économique et social du pays inhérentes aux changements climatiques en mettant l’accent sur un modèle applicable pour les forêts au Niger. -
Impacts des changements climatiques dans les secteurs de la faune et de la pêche au Niger
Il apparaît alors que les changements climatiques, notamment les baisses de précipitations devenues récurrentes au Niger, constituent de sérieuses menaces sur les plans socioéconomique et environnemental. La présente étude a été conduite pour i) mieux aider à cerner les impacts des changements climatiques sur les secteurs de la faune et de la pêche, pourvoyeurs importants de revenus, d’emplois, de produits alimentaires, thérapeutiques et conséquemment ii) proposer des stratégies d’adaptation. -
Impacts des changements climatiques sur le sous-secteur de l’élevage au Niger
Pays sahélien aux trois quart désertique, le Niger est concerné à l’instar des autres pays par les préoccupations mondiales relatives à la problématique du changement climatique qui se manifeste essentiellement par la hausse des températures, la modification du niveau et de la variabilité de la pluviométrie, etc. La présente étude porte sur l’évaluation des risques liés aux changements climatiques pour le sous-secteur de l’élevage à l’horizon 2050 et à proposer des stratégies pour y faire face. -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger
La présente étude qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante nationale PAA, porte sur l'évaluation des impacts lies aux changements climatiques pour les secteurs clés du développement économique et social du Niger afin de mieux asseoir les mécanismes adéquats de planification à long terme de I ‘adaptation dans les politiques et stratégies de développement. -
Changement climatique, géomorphologie et inondabilité de la plaine alluviale du fleuve Niger à Niamey (Niger)
La plaine alluviale du fleuve Niger à Niamey connaît depuis 2010, des inondations récurrentes qui provoquent des dégâts socioéconomiques et environnementaux considérables. Des études antérieures ont montré le rôle des facteurs aggravants comme les fortes précipitations et la déforestation des versants. L’objectif de cette étude est de montrer le rôle déterminant de la morphologie du lit mineur comme facteur de prédisposition dans un contexte de changement climatique; avec comme hypothèse selon laquelle les berges convexes ensablées sont les plus vulnérables au risque d’inondation. La méthodologie a consisté à étudier la pluviométrie de 6 stations, à caractériser la géomorphologie, des levés topographiques et à cartographier les zones inondables, l’évolution des systèmes hydrologiques en amont de Niamey. Les résultats montrent que la convexité des berges surtout en cas de forte sédimentation et la faible profondeur du lit mineur constituent les facteurs majeurs de prédisposition au risque d’inondation. -
Le changement climatique. Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour jeunes (JFFLS) – guide de l’animateur
Le but de ce module est de fournir aux animateurs de la JFFLS des informations qui leur permettent d’aborder le sujet du changement climatique, en particulier son impact sur l’agriculture et les actions que les agriculteurs peuvent entreprendre pour réduire leur vulnérabilité à ce changement. -
Évaluation du risque multi-aléa dans les communes de la Région de Dosso au Niger
Entre 2010 et 2016, en Afrique de l’Ouest, 715 projets de réduction du risque hydro-climatique, d’adaptation et de résilience au changement climatique (CC) ont été lancés pour un montant de 7,3 milliards de dollars américains (OECD). Avec le terme « risque » nous nous référons à la « probabilité d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux que viennent amplifier les conséquences de tels phénomènes lorsqu’ils se produisent » (GIEC 2013). -
Modélisation simultanée de la perception et de l'adaptation au changement climatique : cas des producteurs de maïs du Nord Bénin (Afrique de l'Ouest)
Au Bénin comme dans la plupart des pays en développement, les producteurs sont de plus en plus confrontés au besoin d’adapter leurs systèmes de cultures aux circonstances changeantes du climat. Cet article a pour objectif d’analyser l’adaptation des producteurs de maïs au changement climatique -
Facing climate variability in sub-Saharan Africa: analysis of climate-smart agriculture opportunities to manage climate-related risks
In the literature, a lot of information is available about climate change perceptions and impacts in sub-Saharan Africa. However, there is limited attention in the region to emerging initiatives, technologies and policies that are tailored to building the adaptive capacity of agricultural systems to climate change and variability. In this paper, we discuss the prospects for climate-smart agriculture technologies and enabling policies in dealing with climate change and variability at different sub-regional levels of sub-Saharan Africa to sustain farm productivity and livelihoods of agrarian communities -
Climate-smart agriculture : pour une agriculture climato-compatible
L’agriculture intelligente face au climat (climate-smart agriculture – CSA) a comme objectifs d’être adaptée au changement climatique et de l’atténuer, tout en contribuant de manière durable à la sécurité alimentaire. -
Atlas agroclimatique sur la variabilité et le changement climatique au Niger
Sur la base d’analyse des observations climatiques historiques, d’analyse du climat futur, et de simulations à l’aide de modèles de cultures, cet atlas contient un ensemble de représentations cartographiques, graphiques et tabulaires qui permet de répondre aux questions que posent les citoyens sur les changements climatiques. -
Les impacts du changement climatique sur les rendements agricoles en Afrique de l’Ouest
Impacts du changement climatique sur la production agricole -
Étude pour l’intégration de la problématique des changements climatiques dans la stratégie d’intervention du programme LUCOP. Volume 2 : contexte et impacts des changements climatiques au Niger et dans les zones d’intervention, Octobre 2008
Le Niger, faisant partie intégrante de l’Afrique de l’Ouest et Sahel, est donc touché par le même phénomène des CC. Les impacts se pose avec la même acuité que pour l’ensemble de la zone sahélienne. -
Document cadre pour l' amélioration de la résilience de l'élevage face à la variabilité et au changement climatique au Niger.
La variabilité et les changements climatiques (CC) constituent une menace importante pour le développement économique et risquent de compromettre les chances de relever les défis de réduction de la pauvreté. Or, l’intégration des CC au processus de planification du développement représente encore un défi pour les pays de l’Afrique au Sud du Sahara. -
Les productrices maraîchères de la commune Rurale de Tondikiwindi (Niger) s’adaptent à l’adversité climatique
La campagne agricole 2011-2012 au niveau national en général et régional en particulier a été caractérisée par un déficit céréalier qui a conduit le gouvernement nigérien à élaborer un plan de soutien aux populations vulnérables et à demander l’appui des différents partenaires en vue d’y faire face. -
AVSF - Réponses paysannes aux changements climatiques
Les paysans : premières victimes du changement climatique. Le réseau VSF Europa lance une campagne européenne sur le petit élevage face au changement climatique. Ne pas confondre [petits] éleveurs et [gros] pollueurs Selon le rapport mondial 2011 sur l'élevage de la FAO, 120 millions de personnes dépendent de leur bétail pour assurer leur sécurité alimentaire. A l'opposé d'une agriculture intensive, des centaines de millions de petits producteurs dans le monde luttent contre le réchauffement climatique et en sont de fait les premières victimes. La principale cause du changement climatique est l'émission de gaz à effet de serre. Hors, l'activité d'élevage dans son ensemble représente 18 % de ces émissions de gaz. Pourtant, la contribution des petits élevages ne doit pas être confondue avec celle des élevages intensifs, grands consommateurs d'énergie fossiles. Un réseau européen au service d'une cause mondiale AVSF appartient au réseau VSF Europa qui soutient le petit l'élevage pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition. Cette vidéo a été réalisée pour une campagne européenne de sensibilisation sur le rôle déterminant de l'élevage paysan pour répondre aux impacts du changement climatique. Elle a été tournée à Madagascar, en Iran et au Sud Soudan en 2011 pour mieux comprendre les stratégies d'adaptation qu'ont développées les éleveurs paysans. Pour suivre cette campagne : www.smallscalefarming.org -
Expérience d’une résilience des écosystèmes et des communautés locales aux changements climatiques
Gestion Durable des Terres au Burkina Faso: expérience d’une résilience des écosystèmes et des communautés locales aux changements climatiques -
Le changement climatique en Tunisie : pouvons nous nous adapter ?
Cette vidéo présente le changement climatique en Tunisie et différentes stratégies d'adaptation -
Adaptation au changement climatique
Cette vidéo explique ce qu'est l'adaptation au changement climatique -
Caractérisation des stratégies d'adaptation au changement climatique en agriculture paysanne
Etude de capitalisation réalisée sur les terrains de coopération d’AVSF -
Stratégie et Plan National d'Adaptation de l'Agriculture face aux changements climatiques
Ressources documentaires sur les changements climatiques, leurs impacts et l'agriculture intelligente face au climat -
Renforcement des capacités des maraîchers des Communes de Adjohoun, Bopa, Aplahoué, Ouaké, Malanville, Sô-Ava sur la protection phytosanitaire aux fins de l’adaptation aux changements climatiques
Au Bénin comme dans d’autres pays de la région Ouest-africaine, la production maraîchère est devenue depuis quelques années une activité en pleine expansion, en particulier dans les sites urbains et périurbains. En dépit de son importance vitale pour la production vivrière et de sa contribution non négligeable en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la filière maraîchère reste confrontée à de nombreux défis au nombre desquels figurent la non maîtrise des dégâts des nuisibles (insectes et ravageurs), la méconnaissance des techniques de gestion intégrée des ravageurs et les effets induits par la variabilité et les changements climatiques. -
Fiche n°2 sur les techniques d’agriculture climato-intelligente : Diffusion du système de riziculture intensive pour l’amélioration de la production agricole au Sud Bénin
Cette fiche technique est réalisée dans le cadre du projet « intégration de l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau en Afrique de l’Ouest » qui est financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM/CC). Il est porté par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et mis en oeuvre par le Centre régional AGRHYMET basé à Niamey, Niger. Dans le cadre de l’appui aux organisations de producteurs sur les techniques innovantes d’adaptation au changement climatique, le projet FFEM/CC appuie le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Benin (CCR-B) sur la mise en oeuvre du système de riziculture intensive (SRI) qui permet d’améliorer la résilience des producteurs à l’insécurité alimentaire. -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger -
Impacts des changements climatiques sur le sous-secteur de l’elevage au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques sur le sous-secteur de l’elevage au Niger -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’energie au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur de l’energie au niger -
Impacts des changements climatiques sur les forets au Niger
Ce présent rapport porte sur les impacts des changements climatiques sur les forets au Niger -
Impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger -
Scénarios de changement climatique sur le Niger
Ce rapport a été élaboré dans le cadre du Programme Africain d’Adaptation (PAA) et vise à développer des scénarios de changements climatiques pour le Niger, faire l’évaluation approfondie des risques de changement climatiques et leurs impacts sur les secteurs clés de l’économie (agriculture, élevage, foresterie, pêche, énergie, ressources en eau, santé et zones humides), évaluer les modèles climatiques existants, sortir des projections de précipitations et températures dans un horizon spatiotemporel adéquat et en ressortir les incertitudes. L’étude avait également pour objectif de faire une évaluationdesbesoinseninformationsetdonnéesimportantespourvalideretadapterlessortiesdeces différents modèles climatiques au Niger -
Programme d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques
Le présent document élaboré par le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) constitue le Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des Changements Climatiques (CC). Son élaboration entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et du Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (SN/PACVC) élaborés en avril 2003 et adoptés en mars 2004. Cette Stratégie entre elle dans le cadre du Programme Changements et Variabilité Climatiques, un des six programmes prioritaires du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD). -
Contribution Prévue Déterminée au niveau National - CPDN (INDC) du Niger
Ce présent rapport porte sur la Contribution Prévue Déterminée au niveau National - CPDN (INDC) » du Niger -
Plan d'investissement climat pour la région du Sahel - Volume 4 : dispositif institutionnel de mise en œuvre
Le présent volume traite du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS 20182030, ainsi que des différentes parties prenantes qui y contribuent. Il fait partie intégrante du Plan d’Investissement Climat de la Région du Sahel. -
Plan d'Investissement Climat pour la région du Sahel -- Annexe 3 : plan de suivi - évaluation pour la mise en œuvre du pic-rs (2018-2030)
Ce rapport porte sur le plan de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du PIC-RS -
Plan d'Investissement Climat pour la Région du Sahel - Programme régional prioritaire (PRP 2018-2020)
Ce présent rapport porte sur le plan d’Investissement Climat de la Région du Sahel (PIC-RS), -
Plan d'investissement climat pour la région du Sahel - Volume 2 : plan d’investissement climat pour la région du sahel
Ce présent rapport porte sur le processus d’élaboration d’un Plan d’Investissements Climat pour la Région du Sahel, qui tire son fondement du « Sommet Africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale » tenu le 16 novembre 2016 à Marrakech et qui a regroupé plusieurs Chefs d’État et de délégation d’Afrique, en marge de la 22ème Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22). -
Troisième communication nationale a la conférence des parties de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques
Ce rapport porte sur la troisieme communication nationale a la conference des parties de la conventioncadre des nations unies sur les changements climatiques -
Avant-projet de document de politique nationale en matière de changements climatiques (PNLCC)
Ce présent rapport porte sur L'analyse de la situation en matière de changements climatiques, les actions initiées en réponse aux variabilités et changements climatiques , les objectifs et axes de la Politique Nationale en matière de Changements Climatiques (PNCC) et le dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation -
Rapport national Conférence de Rio + 20
Ce présent rapport porte sur la rencontre décennale, également appelées « Sommets de la Terre », qui offre l’opportunité aux dirigeants mondiaux de se réunir pour définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial -
Adaptation face aux changements climatiques et agriculture intelligente face au climat au Niger
Ce rapport porte sur l'adaptation face aux changements climatiques et l'agriculture intelligente face au climat au Niger. -
Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole : SPN2A 2020-2035
Ce présent rapport porte sur la Stratégie et le Plan National d’Adaptation de l’Agriculture face aux changements climatiques (SPN2A) entendent contribuer à l’intégration de l’adaptation aux effets attendus des changements climatiques dans la planification et la mise en œuvre du développement du secteur agricole au Niger. Elle a pour objectif de guider l’opérationnalisation des actions prévues dans ce secteur prioritaire de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), avec pour finalité l’amélioration de la résilience des populations agricoles du Niger face au climat et à d’autres facteurs de risque. -
Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole (SPN2A) 2020-2025
Ce présent rapport porte sur la Stratégie et le Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole (SPN2A 2020-2035) entendent contribuer à l’intégration de l’adaptation aux effets attendus des changements climatiques dans la planification et dans la mise en œuvre du développement du secteur agricole au Niger. Ils ont pour objectif de guider l’opérationnalisation des actions prévues dans ce secteur prioritaire de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), avec pour finalité l’amélioration de la résilience des populations agricoles du Niger face au climat et à d’autres facteurs de risque. Ce faisant, ils contribuent également à la formulation en cours du Plan National d'Adaptation (PNA). -
Appui à la formulation concertée de la SPN2A pour la République du Niger : Elaboration des projections climatiques désagrégées pour le Niger
Ce rapport porte sur l'élaboration de projections climatiques désagrégées pour le Niger -
Evaluation désagrégée de l’impact des changements climatiques au Niger sur les risques de dégradation des terres, les rendements agricoles et la production de biomasse herbacée
Le présent rapport porte sur l'évaluation désagrégée de l’impact des changements climatiques au Niger sur les risques de dégradation des terres, les rendements agricoles et la production de biomasse herbacée -
Identification et évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger - Volume 1
Ce rapport porte sur l'identification et l'évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger -
Identification et évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger - Volume 2
Ce rapport porte sur l'identification et l'évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger -
Climate Facts Sheet - Niger
Cette fiche décrit les tendances d'évolutions du climat au Niger, à partir d'une revue de données internationales -
Climate Change and Variability in the Sahel Region
Le présent rapport porte sur le changement climatique et variabilité dans la région du Sahel, les impacts et stratégies d'adaptation dans le secteur agricole -
Le réchauffement climatique observé depuis 1950 au Sahel
Ce rapport porte sur le réchauffement climatique observé depuis 1950 au Sahel -
Analyse des phénomènes climatiques extrêmes dans le sud-est du Niger
Le climat du Département de Gouré et de Mainé Soroa (sud-est du Niger) est de type saharo-sahélien. Les évènements climatiques extrêmes sont des phénomènes météorologiques localisés, à la fois dans l’espace et le temps et qui causent beaucoup de dommages à l’agriculture, à l’élevage et aux ressources naturelles. Afin de qualifier et quantifier régionalement les extrêmes climatiques, l’outil statistique utilisé est la distribution des valeurs extrêmes selon la loi de Gumbel. Ces résultats montrent que l’occurrence des jours et des nuits chauds tend à augmenter et celles des nuits froides à diminuer. -
Compilation et analyse des informations disponibles sur le climat actuel et futur au Niger et \ ou régional
Cette étude est une compilation des informations climatiques nécessaires pour préparer les analyses de vulnérabilité et les stratégies d'adaptation dans le cadre du plan national d'adaptation. Au début de la mission des entretiens ont été menés avec des personnes clés, ce qui a révélé que le Niger n'avait pas un accès suffisant à des informations climatiques de haute résolution. Ce rapport compile les données climatiques existantes et accessibles au public ainsi que le problème de leur taille, des formats de données inhabituels et des approches de leur analyse. Le rapport suit quatre axes des recommandations -
Evaluation de la performance des modèles climatiques sur le Niger
Cette étude évalue la performance des modèles climatiques sur le Niger -
Evaluation de la performance des modèles climatiques sur le Niger
Le présent rapport porte sur la composante 2 du PDIPC (appui à la recherche en modélisation et évaluation de vulnérabilité). IL est le résultat d'une étude intitulée Identification des Modèles Climatiques Régionaux les Plus Performants et le Downscaling Statistico-Dynamique des Modèles Globaux les plus Performants pour le Niger. L'étude s'est déroulée en 7 phases distinctes -
Agricultures familiales en contexte de changement climatique
"Les agricultures familiales en contexte de changement climatique" est le thème utilisé en 2014 au Niger pour célébrer la journée de lutte contre la désertification. La désertification contribue significativement à la dégradation des terres et dont des ressources naturelles. Cette présentation montre en effet, l'impact de la désertification sur la brousse tigrée du Niger. -
Le manioc : une culture de résilience au changement climatique
La culture du manioc est pratiquée par les producteurs pour la vente et la consommation familiale. Dans la région de Zinder, le manioc est cultivé sur les sites maraichers et aussi dans les champs de culture pluviale. Le manioc est de plus en plus cultivé à Zinder, particulièrement dans les communes de Doungou, Magaria et Dan Barto, qui ont été visitées pour ce travail, à cause de sa rentabilité, sa faible exigence d’entretien, sa résistance à des conditions difficiles du milieu (température élevée, stress hydrique, etc.) et son adaptation aux changements climatiques. Sur les sites visités, 80 à 100% des producteurs cultivent le manioc. -
Interactions entre la variabilité des écotypes de l’oignon (Allium cepa L.) et les facteurs agro-climatiques au Niger
L’oignon est la première culture maraîchère au Niger. La production annuelle est estimée à près de 561.000 tonnes, classant le Niger au deuxième rang des producteurs ouest-africains derrière le Nigeria. Une collecte portant sur des cultivars locaux d’oignon du Niger réalisée en 2008 a été suivie d’une étude de leur interaction avec les facteurs agro-climatiques du Niger. Les méthodes classiques de collecte de matériel végétal (localisation des sites de collecte sur la carte, identification et description des échantillons, historique des écotypes, conditions culturales, etc..) ont été utilisées. L’aspect variétal vis-à-vis des facteurs agroclimatiques des différentes zones de collecte a été mis en évidence. Le travail a permis de réunir 21 écotypes locaux d’oignon comprenant le Violet de Galmi répartis sur toute la zone de collecte. Il a également permis de montrer que certaines caractéristiques variétales comme la couleur des bulbes, le cycle sont liées aux différences agro-climatiques et géomorphologiques des sites de collecte tandis que d’autres se révèlent indifférentes. -
Suivi des sites PASEC Site de Tokaraoua (commune de Gabi)
Le site de Tokaraoua se situe dans la commune de Gabi dans une forêt classée à une distance d’environ 5 km de la ville de Gabi. Il une vocation pastorale. Cinq villages sont riverains et bénéficiaires de ce site, à savoir : Tokaraoua Tabodi, Takaraoua Tagabas, Tokaraoua Tajaé, Hassaou, Dan Takobo. Ce site était envahi par le Sida cordifolia qui est une plante non appétée par les animaux. Ce fléau a pu bien se développer dans la zone et a couvert les espaces d’aires de pâturage pour les animaux. Les peuplements de cette espèce sont parvenus à dominer les autres espèces herbacées appétées par les animaux. -
Note sur la disponibilité des semences améliorées dans la région de Maradi pour la campagne 2019
La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Maradi est engagée, dans le cadre des activités du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC), à informer et sensibiliser les producteurs de la région sur la pratique de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC). On note parmi les techniques AIC recommandées, l’utilisation de semences améliorées. L’utilisation de ces semences améliorées contribue à l’adaptation de notre agriculture aux changements que connait aujourd’hui le climat et cela grâce à certaines de leurs caractéristiques : précocité, résistance au stress hydrique, résistance à des maladies, résistance au striga, résistance à certaines attaques, bon rendement… L’objectif visé par la CRA est de contribuer à rehausser l’utilisation des semences améliorées par les producteurs de la région. Ainsi, la CRA informe les producteurs sur l’importance de l’utilisation des semences améliorées, leur disponibilité, les prix et également les points de vente. Cette information se fait via plusieurs canaux à savoir des émissions radio, des notes d’information et l’application WhatsApp. -
Fiche technique de mise en place de haies vives avec Commiphora africana (dashi)
Commiphora africana, appelé en haoussa ‘’dashi’’, est un arbuste qui peut atteindre environ 5 m de hauteur, dont les feuilles se développent au début de la saison pluvieuse ou peu de temps avant, et se perdent au début de la saison sèche. C’est une espèce très utilisée pour l’installation des haies vives dans la région de Zinder. Sa plantation se fait par bouturage en saison sèche, avec des écartements de 0,25 à 0,5 m entre les boutures. Le besoin est donc de 1.600 ou 800 boutures pour délimiter 1 ha selon les écartements. La mise en place des haies vives de cette espèce ne demande forcément pas des dépenses financières. Les haies vives de Commiphora africana protègent les cultures contre le vent, les animaux et procurent du fourrage pour l’alimentation animale. Elles jouent ces rôles après 1 à 2 ans de plantation. Cette espèce végétale ne demande pas des travaux d’entretien pour les haies vives. -
Changements climatiques : Impacts sur l’eau et l’agriculture en Afrique de l’Ouest
Les changements climatiques se manifesteront sur toutes les composantes du cycle de l’eau, comme par exemple, la quantité et la distribution des précipitations, la fréquence et la durée des sécheresses, ainsi que l’évaporation et le bilan hydrique à la parcelle. La mousson africaine, qui rythme la vie des 300 millions d’Africains de l’Ouest, devrait se modifier : la variabilité interannuelle des précipitations liées à cette mousson devrait augmenter, tout comme l’occurrence des précipitations extrêmes. Les activités agricoles seront plus ou moins fortement affectées par ces changements, en fonction des zones agroécologiques et des spéculations. Dans tous les cas, différents travaux estiment que le ruissellement moyen et la recharge des nappes baisseront ; que la concurrence pour l’eau sera exacerbée suite à des demandes croissantes pour d’autres usages comme la production d’hydro-électricité. Les travaux menés par le Programme international de recherche sur la mousson africaine (AMMA) établissent sans ambiguïté que la variabilité spatio-temporelle excessive des précipitations est un réel frein à la production agricole. Les sociétés devront s’adapter. Néanmoins, il convient de ne pas sous-estimer la complexité de l’approche. Ainsi les plans d’irrigation sont à raisonner avec l’ensemble des acteurs et utilisateurs d’un territoire, voire d’autres pays, placés en aval des prélèvements pour l’eau d’irrigation. De nombreuses techniques, et leurs variantes locales, existent pour faire face à l’aléa hydrique. Elles visent en général à accroître la production, tout en minimisant sa dépendance aux intrants et en limitant les impacts négatifs sur l’environnement, et leur vulnérabilité. Ces techniques incluent la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols.