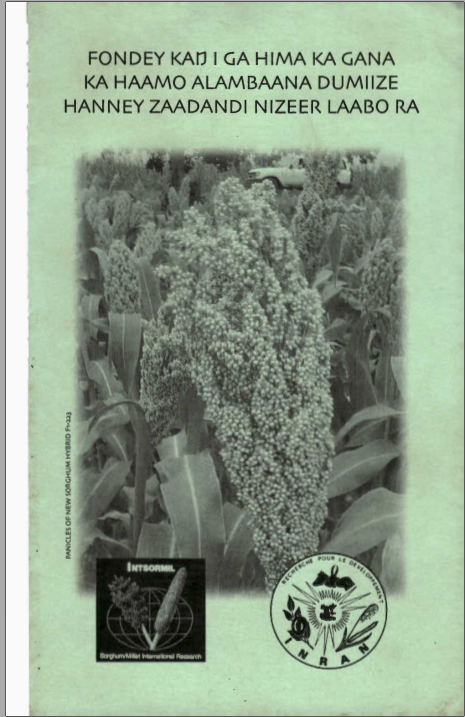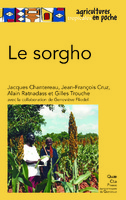Contenus
Site
Bibliothèque numérique DUDDAL
Sujet est exactement
Sorgho
-
Effets de la transplantation des plants du mil (Pennisetum glaucum (L) R. Br.) et du sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench) sur des soles récupérées à l’aide des demi-lunes dans la commune de Bagaroua au Niger
La présente étude a pour objectif de tester les comportements du mil et du sorgho vis-à-vis des effets de la transplantation des plants préalablement cultivés en pépinière au niveau des demi-lunes. -
Projet de développement intégré des systèmes semenciers au Sahel : sorgho-Niger
Les superficies récoltées en sorgho au Niger sont passées d’environ 2 500 000 ha en 2009 à plus de 3 700 000 ha en 2019 (Figure 1). La production du sorgho a évolué progressivement d’environ 730 000 tonnes à près de 1 900 000 tonnes entre 2009 et 2019 (Figure 2). Enfin, le rendement, à l’instar de la surface récoltée et de la production a progressivement augmenté de 0,3 t/ha à 0,5 t/ha entre 2009 et 2019. -
Les variétés de semences certifiées disponibles dans l’Annuaire National 2024 mil – sorgho – niébé - arachide
L’Annuaire National 2024 de disponibilité en semences des variétés améliorées au Niger est un référentiel pour l’ensemble des usagers de la filière semencière au Niger. Il est édité par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage1. C’est le document officiel qui contient la quantité et la liste exhaustive de toutes les semences des variétés améliorées produites au Niger en 2023. Il renferme également les reports des quantités de semences invendues de l’année passée (production 2022). Il offre et facilite ainsi l’accès aux utilisateurs à une diversité de semences de qualité de variétés améliorées. Cette note a été rédigée à partir des données présentées dans l’annuaire 2024. -
Impacts potentiels du changement climatique sur les rendements du mil et du sorgho cultivés dans les communes rurales au Niger
Le changement climatique constitue une menace majeure pour les populations de l’Afrique de l’Ouest, en général et du sahel, en particulier. Le Niger est, pleinement, concerné par cette situation qui se traduit par une grande variabilité pluviométrique et une forte récurrence de sècheresses depuis les années 1970s. Cette étude analyse l’impact du changement climatique sur les rendements du mil et du sorgho dans les Communes rurales de Balleyara, Dan Issa, Dogo, Harikanassou, Illéla, Magaria et Mokko, au Niger. Deux variétés de mil (HKP et SOMNO) et une de sorgho (Caudatum) ont été testées. -
Le haricot mungo, Vigna radiata (L.), une alternative à l’association sorgho-niébé pour la diversification des cultures en conditions soudano-sahéliennes ?
La diversification des cultures est un des leviers qui pourraient contribuer à stabiliser, voire améliorer, les rendements dans les régions soudano-sahéliennes contraintes par des conditions climatiques semi-arides et des sols très faiblement fertiles. Elle peut permettre aussi d’atténuer les risques liés aux marchés. Cette diversification peut être mise en œuvre par la pratique des associations et des rotations ainsi que par l’enrichissement de celles-ci avec de nouvelles espèces. Pendant trois années d’expérimentation, nous avons comparé sept espèces, dont quatre légumineuses y compris le haricot mungo, cultivées seules ou en association avec le sorgho. Le haricot mungo est apparu comme une espèce très bien adaptée aux conditions semi-arides du Burkina Faso. Parmi les sept espèces testées, c’est celle qui a produit le plus de grains, entre 0,8 et 1,8 t ha 1 en culture pure et entre 0,35 et 0.9 t ha 1 en association avec le sorgho. Nos résultats confirment aussi le gain de rendement de la culture de sorgho associée avec les légumineuses par rapport à la culture pure. Vingt-cinq producteurs du centre nord du Burkina Faso ont testé le haricot mungo dans leurs parcelles et apprécié sa productivité et sa rusticité. Ils ont obtenu un rendement moyen de 0,7 t ha. Toutefois, l’absence de marché, par comparaison au niébé, reste un frein à sa diffusion. -
Améliorer le niveau de vie des paysans en Afrique de l’ouest Semi-aride en améliorant les rendements du mil et du sorgho
Les contraintes à la production agricoles sont nombreuses, il est impératif de s’attaquer aux contraintes majeures si non toutes. Les intempéries climatiques font que les variétés locales productives tendent à disparaître à cause de la sécheresse, des attaques des plantes et insectes parasites , de la baisse de la fertilité des sols. C’est pourquoi, il faut s’orienter vers la recherche d’une solution durable contre ces fléaux, afin de permettre aux paysans de subvenir à leurs besoins alimentaire et bien être. C’est ce que le projet PROMISO s’attèle à réaliser à travers son intervention direct en milieu paysans. -
Contribution à l'amélioration de l'agriculture de conservation (conservation farming) dans la commune rurale de Doungou (Kantché/Zinder)
Cette étude à contribuer pour l'amélioration de l'agriculture de conservation dans la commune rurale de Doungou. Les données sont collectées à travers des enquêtes individuelles. -
Impact des techniques de conservation des eaux et des sols sur le rendement du sorgho au centre-nord du Burkina Faso
Depuis 1961, le Burkina Faso a connu de multiples projets de développement dont la plupart avait pour objectifs l’autosuffisance alimentaire, la conservation des eaux et des sols, l’agroforesterie, la lutte contre la désertification, la gestion des terroirs, le développement humain durable, la lutte contre la pauvreté. Tous ces projets, débutés dans les années 1960 dans le nord-ouest du pays, au Yatenga, ont comporté un volet sauvegarde de l’environnement et de l’espace vital avec comme points focaux la récupération des terres dégradées et le maintien de la fertilité des sols. Entre 1995 et 2002 dans les 7 provinces que sont le Passoré, le Sanmatenga, le Bam, le Yatenga, le Boulkiemdé, le Sanguié et le Namentenga, du bilan des activités de la phase 2 du Programme Spécial de Conservation des Eaux et des Sols et d’Agroforesterie (PS/CES-AGF), il ressort les réalisations suivantes : 20 202 fosses fumières, 747 digues filtrantes, 32 424,2 ha de zaï, 311,3 ha de demi-lunes et des milliers de plants. Dans le centre-nord du Burkina Faso, particulièrement dans la région de Dem, différentes techniques ont été mises en œuvre par les populations paysannes, le plus souvent avec l’appui de multiples projets, ONG et services techniques décentralisés de l’État. -
Estimation des rendements et de la rentabilité économique de production de trois cultures : le sorgho, le niébé et la dolique à Djirataoua (Maradi – République du Niger)
Un essai de production du sorgho, du niébé et de la dolique a été conduit en 2014 sur le périmètre irrigué de Djirataoua. Il vise à estimer les rendements en fourrage et en grain, déterminer la composition chimique du fourrage et évaluer la rentabilité économique de production des trois cultures. Méthodologie et résultats : L’essai est un bloc complet randomisé de trois traitements en quatre répétitions. Les données sont collectées sur le cycle végétatif des cultures, le coût des intrants utilisés, les coûts de la main d’œuvre pour les travaux et les prix des différents produits et sous-produits obtenus après la récolte. -
Fondey kai i ga hima ka gana ka haamo alambaana dumiize hanney zaadandi nizeer laabo ra
Dumize zaadandiyaiJ wo goy no kaiJ ga naiJ alfarey duura ma tonton farmo do hare. Dumi kaiJ i mana goy, goyyaiJ hanno wala nongu kaiJ i mana soola, dumo din fattayaiJo gonda karha gumo ; a ga ganji alfaro ma du nafaa kaiJ a miile. Alfarey kulu ma du ga nafa nda dumi Alambaaney se no, INRAN saruuso nda laabo gaakasinayko yaiJ go ga gurjay alfarey baafuna ma boori, me-IJWaaro ma du ka ba gumo. INRAN saruuso no ga haggoy nda kuray nda farmi bol) ceeciceeciyaiJey Nizeer laabo ra. INTSORMIL mo, AMILKA laabo saruusi no kaiJ go ga INRAN gaakasinay a ma ceeci-ceeciyal) te hayni nda haamo dumey boiJ. WINROCK mo, sata no kaiJ ga alfari hina buuney gaakasinay i ma du meIJWaari wasante nda arzaka. -
Catalogue Régionale des Espèces et Variétés Végétales : CEDEAO-UEMOA-CILSS
Le catalogue Régional CEDEAO-UEMOA-CILSS des Espèces et Variétés est un instrument majeur du règlement semencier harmonisé. Il est prévu que sa mise à jour soit annuelle et son édition chaque deux ans. La mise à jour du catalogue régional se fait à partir des informations découlant des catalogues nationaux révisés par des Etats de l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS. En effet, le règlement semencier harmonisé dispose en ses articles 9 pour le Règlement C/REG.4/05/2008/CEDEAO et 80 pour le Règlement N°03/2009/CM/UEMOA, que le catalogue Régional est << le document officiel qui contient la liste de toutes les variétés végétales homologuées dans les États membres>>. -
Irrigation de complément et culture du sorgho au Burkina Faso
L’étude vise à comparer l’effet de l’irrigation de complément sur le sorgho avec les impacts liés à deux techniques d’économie en eau éprouvées en cultures pluviales que sont : le labour suivi de buttage cloisonné et les semis sur des billons cloisonnés. L’étude a été réalisée au Burkina Faso, d’une part à Saria en zone nord-soudanienne et, d’autre part, à Sabouna, en zone sahélienne, avec des pluviométries moyennes annuelles respectives de 750 et 400 mm. La pluviométrie actuelle au Sahel ne semble pas permettre aux techniques d’économie de l’eau d’être plus performantes que l’irrigation de complément. Au cours de l’année 1987, à Saria en zone plus humide, les techniques d’économie d’eau éprouvées en cultures pluviales ont induit des rendements en sorgho-grain significativement supérieurs à ceux obtenus avec l’apport d’une irrigation de complément de 53 mm pendant les «trous pluviométriques». -
Productivité de la culture du sorgho (Sorghum bicolor) dans un système agroforestier à base d’Acacia senegal (L.) Willd. au Niger
Les sols sahéliens se caractérisent par un faible niveau de fertilité dont l'amélioration se fait par l'épandage de fumier organique ou d'engrais. Cependant, les contraintes économiques des ménages limitent leur adoption. Des options ne nécessitant aucune sortie monétaire notamment l'intégration à la culture de la végétation ligneuse naturelle constitueraient des alternatives plus en adéquation avec les conditions socio-économiques des paysans. -
Irrigation de complément et culture du sorgho au Burkina Faso
L’étude vise à comparer l’effet de l’irrigation de complément sur le sorgho avec les impacts liés à deux techniques d’économie en eau éprouvées en cultures pluviales que sont : le labour suivi de buttage cloisonné et les semis sur des billons cloisonnés. L’étude a été réalisée au Burkina Faso, d’une part à Saria en zone nord-soudanienne et, d’autre part, à Sabouna, en zone sahélienne, avec des pluviométries moyennes annuelles respectives de 750 et 400 mm. La pluviométrie actuelle au Sahel ne semble pas permettre aux techniques d’économie de l’eau d’être plus performantes que l’irrigation de complément. -
La SSD-35 une variété de sorgho résistante à la cécidomyie pour améliorer la production et générer des revenus
Le sorgho SSD-35 a été développé au Niger. L’objectif du développement de SSD35 est de résoudre la contrainte d’attaque de la cécidomyie, Stenodiplosis sorghicola (Coquillet) qui est un insecte uniquement rencontré sur le sorgho et cause des dégâts très importants sur les panicules en floraison. La cécidomyie cause plus de dégâts sur les variétés tardives qui développent une mauvaise formation des grains de l’ordre de 50% (Photo1). Parmi toutes les méthodes de lutte préconisées ou recommandées pour lutter contre la cécidomyie beaucoup sont impraticables, modérément effectives ou coûteuses. La résistance variétale est la mieux recommandée car elle est peu coûteuse pour le producteur (Sharmaetal,1992). L’utilisation des variétés résistantes ne nécessite aucun investissement dans le domaine de la lutte contre la cécidomyie. -
Production mixte du sorgho SEPON-82
Au Niger, la disponibilité en quantité et en qualité du fourrage est la contrainte majeure dans l'alimentation du bétail. Le pâturage naturel qui est source de l'alimentation de base est insuffisant. Pour réduire ce déficit et améliorer la qualité du fourrage, il est important de faire la promotion des cultures fourragères des espèces végétales adaptées au milieu et améliorer la production des résidus des cultures. -
L'économie mondiale du sorgho et du mil: Faits, tendances et perspectives
L'économie mondiale du sorgho et du mil: faits, tendances et perspectives est le résultat d'une étude menée en collaboration par la FAO et l'ICRISAT. Ce document examine la structure actuelle de l'économie mondiale de ces deux cultures,et analyse la situation de l'offre et de la demande, actuelle et projetée. Plusieurs tendances ressortant de cette analyse sont examinées, ainsi que leurs éventuelles implications pour la recherche. Le document examine également les principaux obstacles à la production de sorgho et de mil, ainsi que les options en matière de politique qui pourraient contribuer à accroître la production et la qualité de ces cultures dans l'ensemble des régions tropicales semi-arides. -
La culture du sorgho de décrue en Afrique de l'ouest et du Centre
Le sorgho de décrue est cultivé traditionnellement dans de nombreuses localités isolées du Sahel. Les principales zones de culture de ce sorgho sont majoritairement situées dans les lits des fleuves Sénégal et Niger, les cuvettes et les barrages. L'irrigation introduite à la suite de la sécheresse des années 70 et 80 occupe aujourd'hui une bonne partie des lits des fleuves. L'expansion de la culture se fait en Mauritanie à travers l'aménagement de barrages et le contrôle des décrues. -
Bilan-diagnostic sur la production du mil et du sorgho
Le mil et le sorgho sont les deux principales céréales de l’agriculture au Niger tant du point de vue des superficies emblavées, de la production que de leur contribution au stockage de l’alimentation. Ainsi, les deux plantes sont cultivées dans les toutes les régions du pays et y occupent une place privilégiée sauf dans l’Aïr. Malgré cette position privilégiée de ces deux céréales, le Niger, du fait de ses caractéristiques climatiques marquées par des sécheresses périodiques, mais de plus en plus fréquentes depuis pratiquement trois décennies, est devenu structurellement déficitaire. Et toutes les régions en sont marquées. -
Connaissances paysannes sur la conservation du sorgho et du mil dans le département d’Aguié au Niger
Cet article porte sur la conservation du sorgho et du mil dans le département d’Aguié au Niger -
Le sorgho
Ce nouvel ouvrage de la série végétale traite d’une céréale d’origine africaine d’importance, le sorgho, qui occupe la 5e position au monde (venant après les quatre céréales principales que sont le maïs, le riz, le blé et l’orge). Le sorgho est néanmoins, dans bien des régions intertropicales, en Afrique surtout, une culture vivrière primordiale dans les agricultures familiales des zones semi-arides et subhumides où il joue un rôle de culture alimentaire de subsistance. Sa rusticité, ses exigences modérées en eau et la résistance à la sécheresse des variétés locales utilisées sont des qualités essentielles pour les agriculteurs dotés de moyens techniques modestes.