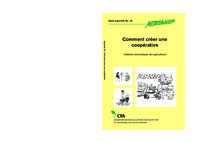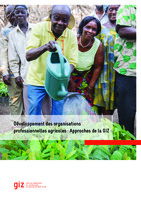Recherche
59 items
-
Curriculum sur l'organisation des producteurs dans la petite irrigation
le présent curriculum relatif à la vie associative et à la gestion des Organisations Paysannes a été élaboré en vue de garantir une formation harmonisée et de qualité à tous les acteurs de la PI.
Il comporte sept (7) modules qui sont :
-- 1 : Gestion administrative et financière d’une OP ;
-- 2 : Planification stratégique et plan d’action ;
- - 3 : Le lobbying et le plaidoyer ;
- - 4 : Gestion d’équipe et de conflits dans une OP ;
- - 5 : Gestion des approvisionnements en intrants agricoles ;
- - 6 : Gestion de la commercialisation des produits maraîchers ;
-- 7 : Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives dans la PI ainsi que les décrets d’application N 2017-829/PRN/MAG/EL (pour les SCOOPS) et N 2017-830 (pour les SCOOP-CA) tous signés et paraphés le 27 octobre 2017. -
Organisation des producteurs de la petite irrigation
Ce guide pédagogique a pour objectif d'aider les formateurs à retrouver les ressources matérielles et techniques d’enseignement appropriées . Il développe 7 modules à savoir:
-- 1 : Gestion administrative et financière des OP;
-- 2 : Planification stratégique et plan d’actions;
-- 3 : le Lobbying et le Plaidoyer;
-- 4 : Gestion d’équipe et des conflits dans une OP;
-- 5 : Gestion des approvisionnements en intrants agricoles;
-- 6 : Gestion de la commercialisation des produits maraîchers;
-- 7 : Acte uniforme (AU) de l’OHADA -
AREN
L'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger est née de la volonté de fédérer les éleveurs autour du développement de ce secteur.
Au niveau du Niger, AREN est membre des structures suivantes :
* Plate-forme Paysanne du Niger Membre fondateur
* Conseil pour l’action et la solidarité paysanne au Niger (CASPANI) Membre fondateur
* Groupement des aides privés (GAP) Membre adhérant
Au niveau sous-régional et international, AREN est affilié :
* au ROPPA (Réseau des Organisations de Producteurs et Paysans d’Afrique) Membre fondateur
* Conseil Mondial des Eleveurs (CME) Membre adhérant
* Réseau des Organisations d’Eleveurs d’Afrique « Billital maroobé » Membre fondateur
* FIPA Membre adhérant
AREN a des relations de travail avec d’autres organisations soeurs notamment du : Nigéria (FULDAN et Mi Yetti Allahà) Bénin (ANOPER) ; Burkina Faso ;
L’objectif visé est surtout les échanges pour faciliter la transhumance transfrontalière -
Gestion des boutiques d’intrants agricoles
Ce module a été conçu par l'ONG Afrique verte Niger avec l'appui financier de l'union européenne pour guider toute organisation de producteurs dans la gestion des intrants agricole. -
FCMN (Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger)
La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya) est une organisation paysanne faîtière créée en 1996 à l'initiative de 11 coopératives des régions de Niamey, Tahoua, Dosso et Tillabery et ce, à la faveur de la loi coopérative régissant les organisations rurales à caractère coopératif. Le mot « Niya » veut dire volonté ou engagement en langue locale et ceci, pour affirmer la détermination des membres à faire de leur organisation une structure phare en matière de développement au Niger. -
ROPPA
Le ROPPA est une initiative propre aux organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest. Il regroupe 13 organisations paysannes nationales membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et des organisations paysannes membres associées (Cap-Vert, Nigeria). -
FUGPN - Mooriben
La Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) compte parmi les toutes premières organisations paysannes constituées librement, par les paysans eux-mêmes, en dehors du système coopératif contrôlé par l’Etat et des structures de la Société de Développement -
Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane (APESS)
L’APESS travaille dans le domaine du Développement Rural en général et le secteur de l’élevage traditionnel en particulier. L’APESS offre donc ses services aux éleveurs et agriculteurs, mais aussi aux responsables et acteurs de différents projets de développement rural. -
Organisation des producteurs de la petite irrigation
Ce présent document porte le renforcement des capacités des acteurs intermédiaires dans l’accompagnement des organisations des producteurs en petite irrigation pour leur développement de leur épanouissement professionnel. -
Comment créer une coopérative ?
Initiatives économiques des agriculteursCe guide propose des lignes directrices pour la structuration d'une coopérative agricole -
Plan opérationnel 2011 de la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger : FCMN-Niya
La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya) est une organisation paysanne faîtière créée en 1996 à l’initiative de 11 coopératives des régions de Niamey, Tahoua, Dosso et Tillabéry et ce, à la faveur de la loi coopérative régissant les organisations rurales à caractère coopératif. Le mot «Niya» veut dire volonté ou engagement en langue locale et ceci, pour affirmer la détermination des membres à faire de leur organisation une structure phare en matière de développement au Niger. Les pas vers la création de la FCMN-Niya ont été posés en 1994 quand des producteurs maraîchers, ne sentant pas leurs intérêts défendus au sein de l’Union nationale des coopératives, ont décidé de créer l’Association des producteurs maraîchers du Niger (APROMANI) avec pour tutelle le Ministère de l’Intérieur. Mais pour se conformer à la nouvelle loi de 1996 régissant le mouvement coopératif nigérien sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, les membres d’APROMANI ont décidé de créer la FCMN. -
Manuel des procédures du Système Collectif de Mise en Marché (SCMMO)
de l'oignonCe manuel des procédures se veut un guide de référence pour toute personne qui intervient dans le système collectif mise en marché des produits agricoles. Il a pour but de présenter les différentes activités reliées au système, du début de la campagne jusqu'à la dernière vente des oignons et l'approbation du rapport de commercialisation par l'Assemblée Générale.
Il présente aussi les responsables, les échéanciers et des documents d'appui de chacune des ces étapes. Enfin, il fait le point sur la hiérarchie décisionnelle du système afin de mieux saisir le rôle entre les élus, permanents et différents organes de l'organisation. -
A quoi sert une association d’usagers de l’eau (AUE) ? Exemple de l’AUE Hadin Kaï autour de la mare de Falki
La mare de Falki se situe dans le département de Mirriah à 4 km au sud de cette localité. Elle a une surface de plus de 100 ha dans sa plus forte extension. Cette mare est utilisée par les populations riveraines pour l’irrigation d’environ 300 ha de cultures maraîchères en saison sèche, pour l’abreuvement des animaux, la pêche mais aussi des usages domestiques (lessive, fabrication de briques, etc.). Toutes ces activités peuvent avoir des répercussions sur la ressource en eau et nécessitent une gestion concertée, de plus en plus indispensable compte tenu des changements climatiques et de l’augmentation des besoins des différentes familles d’usagers. Pour lancer la concertation de tous les usagers sur la gestion de cette ressource, les programmes du FIDA et la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder ont lancé une concertation avec les populations des villages autour de la mare de Falki. A la suite de cette concertation, les populations ont choisi de se réunir en association d’usagers de l’eau (AUE). Cette association réunit les différentes familles d’usagers de l’eau qui ont été identifiées dans des réunions préalables : les maraîchers, les pêcheurs, les éleveurs, les usagers domestiques. -
Une expérience originale de mécanisation partagée en Afrique - les Coopératives d’utilisation de matériel agricole du Bénin
Dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord Bénin), une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) est constituée d’une dizaine d’agriculteurs en moyenne rassemblés autour de l’achat et de la gestion d’un tracteur d’une puissance de 30 à 70 CV, d’une charrue à disques et d’une remorque de trois tonnes. Aujourd’hui, 102 Cuma sont recensées au Bénin, regroupant environ 850 producteurs.
L’objectif premier que se donnent les groupes ayant créé une Cuma porte sur la motorisation du labour, avec en complément, les activités de transport en période de récolte. En moyenne, une Cuma couvre environ 100 hectares par tracteur pour le labour.
Chaque membre contribue aux charges d’exploitation du matériel, proportionnellement à son utilisation. Le montant de l’apport en capital de chaque membre à la Cuma est fonction de ses superficies travaillées. Après des expériences de financement à crédit peu concluantes, les agriculteurs réunissent désormais eux-mêmes la totalité du capital nécessaire pour acheter les équipements. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel – Volume VII – Résultats définitifs – Organisations paysannes
Dans le cadre de la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGA/C), une enquête a été conduite en 2007 en vue de constituer une base de données fiables sur les organisations paysannes au plan national. -
Conscience Politique et Action collective des structures Mata Masu Dubara au Niger - Recherche formative - Rapport de synthèse
Cette étude fait partie d'un vaste programme d'apprentissage contribuant à la Stratégie de Croissance de l'Impact (IGS) de « Femmes en Mouvement » (WOM) de CARE en Afrique de l'Ouest. Le but de cette étude est de tirer les leçons de plus de 25 années d'expérience de CARE Niger sur le modèle Mata Masu Dubara (MMD) qui a fait ses preuves en matière de leadership et d’empowerment des femmes. Il s’agit d’éclairer la mise à l’échelle du modèle MMD et de son impact dans la région Afrique de l’Ouest.
La recherche a appliqué une approche qualitative à la collecte de données, en utilisant les focus groupes et des entretiens semi-structurés. Une équipe de neuf chercheurs, dont les deux principales consultantes qui ont supervisé la recherche, a été déployée. Le choix de neuf (9) fédérations a été fait sur la base de 24 fédérations MMD, existantes dans cinq (5) régions administratives – Niamey, Maradi, Tahoua, Tillabéry, et Zinder -
Appuyer les organisations de producteurs
L’appui aux organisations de producteurs est un enjeu majeur de l’accompagnement des transformations de l’agriculture dans les pays du Sud. C’est un élément essentiel des politiques en faveur de l’agriculture soutenues par la Banque mondiale. Ainsi, beaucoup de gouvernements souhaitent aujourd’hui disposer d’interlocuteurs crédibles pour concevoir et mettre en œuvre des politiques agricoles et rurales efficaces. Malgré ce contexte favorable, les organisations rencontrent des difficultés pour accéder à l’information et aux ressources et pour les gérer au service de leurs membres. Cet ouvrage a pour objectif d’aider le lecteur à se poser « les bonnes questions » : pourquoi appuyer les organisations ? Comment renforcer l’organisation elle-même ? Comment améliorer les relations de partenariat avec les acteurs publics et privés ? Illustrée d’exemples des pays du Sud, cette synthèse valorise des sources documentaires et l’expérience des formations dispensées par l’IRC à Montpellier dans le cadre du mastère « Acteurs du développement rural », animé par des chercheurs du CIRAD et du CIEPAC. Cet ouvrage didactique est destiné aux acteurs du développement agricole de tous les pays. -
Élément de formation N° II : L'organisation du suivi des activités des groupements précoopératifs féminins
Dans le cadre de sa première Phase, le Projet SEN.82.oo4. parvenait à équiper 120 groupements féminins. Dans le cadre de sa deuxième Phase en cours, le Projet devait étendre le bénéfice de disposer dl un équipement de traitement des produits agricoles, à quelque 347 nouveaux groupements. L'organisation comptable, mise en place depuis la Phase I, pour 11 exploitation par les groupements féminins, de Ces différents équipements, ne prévoyait pas de documents transmissibles, par le moyen de copies. -
Note de capitalisation du processus d’émergence des associations d’usagers de l’eau : AUE
La gestion efficiente et durable des ressources en eau dans les zones d’intervention fait parti des préoccupations majeures d’intervention du projet petite irrigation PPI RUWANMU. Cette gestion durable passe avant tout par une responsabilisation des usagers à travers un appui à leurs structurations et un transfert de compétences dans le domaine de la gestion et du suivi de la ressource. Le mot «RUWANMU » en langue Haoussa qui consacre le nom du projet, trouve sa signification dans ce souci permanent de cette responsabilisation des usagers dans l’utilisation, la gestion des ressources en eau qui, il faut le rappeler conditionne leur exploitation de manière durable à des fins diverses, particulièrement dans les domaines des productions agro-sylvo pastorales et halieutiques. -
Une coopérative de production sur un site irrigué communautaire qui marche bien
Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif du Centre d’Information et d’Accompagnement des Promoteurs Agricoles (CIAPA) dans les régions d’intervention du PromAP, l’approche « visite terrain » a été privilégiée, afin de permettre l’adéquation des services fournis avec les réalités du terrain. Des visites ont réalisé dans la région de Dosso pour élargir les références sur des exploitations / fermes souvent qualifiées de « type agrobusiness » qui ne sont pas des exploitations agricoles familiales classiques.Ces exploitations se caractérisent, en général, par des investissements importants en équipement et matériel et sont dirigées par des personnes ayant ou ayant eu une autre activité que l’activité agricole. Ces visites ont pour but de mettre en lumière les expériences existantes au Niger en matière d’irrigation et de techniques de production innovantes, mais également les besoins pouvant être exprimés par ces exploitants afin de mieux cerner leurs attentes. -
Manuel sur les Coopératives à l’usage des Organisations de Travailleurs
Le présent manuel passe en revue l’essentiel à connaître sur les coopératives pour tous ceux qui s’y intéressent comme membres, futurs membres, responsables politiques, personnels des institutions nationales ou internationales chargées de la promotion et du développement des coopératives. Dans un langage simple et compréhensible, le manuel traite tour à tour des particularités et des caractéristiques des coopératives, de l’entreprise coopérative dans son ensemble, de la promotion des coopératives et du lien étroit qui existe entre le BIT et les coopératives. -
Littafin horon mambobin kwamiti mai kula da tafiyar da aiki kamfanin manoma mai kama da kungiya (SCOOP)
Les groupements agricole sont des structures paysannes qui donnent une force aux activités menées dans le sens du développement. Le présent manuel, le démontre à travers les activité de la Société Coopérative : SCOOP. -
Les OP s'organisent pour mieux commercialiser
Depuis 2004, l’Inter-réseaux, avec l’appui du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), mobilise des acteurs du Sud pour partager des initiatives de commercialisation mises en place par des OP, en particulier au Bénin, Cameroun, Mali et en Guinée. Nous donnons ici un aperçu de certaines d’entre elles pour illustrer la diversité des stratégies. -
Le rôle des organisations de producteurs dans les services de conseil rural
Cette note donne un aperçu de cette diversité et précise les conditions qui permettent aux OP de contribuer à la mise en œuvre de SCR accessibles et durables à l’intention des petits exploitants. -
Développement des organisations professionnelles agricoles : Approches de la GIZ
Le présent rapport contient les résultats d’une étude menée entre le 5 octobre et le 13 novembre 2015 à travers l’outil d’enquête en ligne askallo.org. Les représentants de 26 programmes de la GIZ, pour la plupart des programmes bilatéraux et régionaux basés en Afrique et en Asie, ont participé à cette étude. L’objectif principal de l’étude et de ce rapport est de créer une base pour un partage fructueux des leçons apprises, des bonnes pratiques, des stratégies et des instruments pour une promotion effective et efficiente des organisations professionnelles agricoles (OPA) entre les programmes GIZ, et de jeter les bases du développement d’une boîte à outils. Réalisée par le groupe de travail Agribusiness and Food Security (ABFS) du Réseau de développement rural en Afrique (SNRD), cette étude a été saluée par tous les répondants, qui ont souligné le besoin d’échanges accrus sur leurs approches et expériences. La version consolidée de ce rapport a été compilée après des discussions inspirantes lors de la rencontre du SNRD ABFS à Lomé en Mars 2016. -
Rapport de mission : clôture de projet de capitalisation, Atelier final
Dans le cadre du volet « capitalisation » (RA4) du projet Nariindu, RBM a la responsabilité de l’organisation d’un atelier de partage d’expériences sous-régionales, s’appuyant sur les premières conclusions des études pays et sur la synthèse du LARES. Célia Coronel, en tant que responsable « capitalisation » du projet Nariindu, assure un appui technique à RBM et au LARES, et réalisera dans ce cadre des appuis directs à l’occasion de sa mission : appui à la finalisation des rapports pays et de la synthèse du LARES, appui à l’organisation de l’atelier sous-régional, appui à l’animation de l’atelier. -
L’élaboration d’un règlement intérieur pour les opérations de warrantage
La présente fiche est destinée à tous les agents intervenant dans l’encadrement technique et méthodologique des organisations paysannes (OP), notamment celles qui œuvrent dans le domaine du warrantage. La présente fiche concerne donc tous les acteurs du développement, en particulier les faîtières d’OP et les structures d’appui à ces organisations (services techniques de l’État, projets, ONG, etc.). -
La prise en compte du genre dans les différentes étapes du warrantage : une approche en faveur des producteurs et des productrices
Cette fiche de contrôle est destinée à tous les acteurs du développement qui interviennent dans l’encadrement technique et méthodologique des organisations paysannes, particulièrement celles qui œuvrent dans le domaine du warrantage : les faîtières d’organisations paysannes (OP) et les structures d’appui à ces organisations (services techniques de l’État, projets, organisations non gouvernementales, etc.). -
Fiche 1 : Définition et missions des OIP
Il persiste chez les acteurs d’organisations professionnelles du monde agricole, et parfois au sein même des membres des organisations interprofessionnelles (OIP), un flou sur ce qu’est (ou n’est pas) une OIP, son rôle et ses missions spécifiques par rapport aux autres organisations existantes dans le secteur agricole telles que les organisations de producteurs (OP). L’absence de cadres juridiques sur les OIP pendant de nombreuses années en Afrique de l’Ouest et la multiplicité des approches de mise en place de ces organisations développées par les partenaires techniques et financiers et les structures d’accompagnement ont également contribué à maintenir ce « flou ». Cette fiche « Définition et missions des OIP » vise à expliquer le périmètre des OIP et présenter les missions et objectifs qui lui sont généralement assignés. Elle met également en avant les éléments auxquels doivent être attentifs les acteurs des OIP dans la définition de leurs missions. -
Fiche 2 : Mise en place des OIP
Le schéma organisationnel des acteurs impliqués dans les filières agricoles présente plusieurs types d’organisations. Si pour les organisations professionnelles que constituent les groupements, associations paysannes, coopératives, organisations de producteurs (OP) etc., le problème semble ne pas se poser en ce qui concerne la compréhension de leur composition parce qu’elles regroupent des acteurs d’une même fonction (regroupement horizontal) ; ce n’est pas le cas pour les organisations interprofessionnelles (OIP) dont le type de regroupement des acteurs est vertical. Qui peut être membre d’une OIP ? Comment sont identifiés les acteurs pouvant constituer une OIP ? De façon globale, cette fiche « Composition et structuration des OIP » vise à clarifier la question de la composition et de la structuration des OIP. Spécifiquement, elle mettra l’accent sur les catégories d’acteurs rencontrées dans les OIP, la structuration des OIP ainsi que les rôles et responsabilités des organes et des membres. -
Fiche 3 : Composition et structuration des OIP
Le schéma organisationnel des acteurs impliqués dans les filières agricoles présente plusieurs types d’organisations. Si pour les organisations professionnelles que constituent les groupements, associations paysannes, coopératives, organisations de producteurs (OP) etc., le problème semble ne pas se poser en ce qui concerne la compréhension de leur composition parce qu’elles regroupent des acteurs d’une même fonction (regroupement horizontal) ; ce n’est pas le cas pour les organisations interprofessionnelles (OIP) dont le type de regroupement des acteurs est vertical. Qui peut être membre d’une OIP ? Comment sont identifiés les acteurs pouvant constituer une OIP ? De façon globale, cette fiche « Composition et structuration des OIP » vise à clarifier la question de la composition et de la structuration des OIP. Spécifiquement, elle mettra l’accent sur les catégories d’acteurs rencontrées dans les OIP, la structuration des OIP ainsi que les rôles et responsabilités des organes et des membres. -
Fiche 4 : Accords au sein des OIP
Une des principales missions « revendiquées » par les acteurs au sein des OIP et généralement affichées au niveau des cadres réglementaires nationaux sur les OIP en Afrique de l’Ouest est la promotion et la gestion d’accords entre les différentes familles professionnelles. En effet, les OIP constitueraient un des « cadres privilégiés » pour le développement de l’agriculture contractuelle. Pour certains acteurs des OIP, les accords interprofessionnels constitueraient la raison d’être des OIP1. Toutefois, la plupart des OIP rencontrées dans la sous-région semblent avoir du mal à établir des accords interprofessionnels entre les familles d’acteurs, ou dans d’autres cas, à en assurer la mise en œuvre effective. Il existe toutefois des exceptions dans quelques filières, mais les exemples d’aboutissement de ces accords commerciaux sont trop peu nombreux au regard de leur importance. Cette fiche sur les « Accords au sein des OIP » abordera la question autour de plusieurs points : la définition et l’intérêt de l’établissement d’accords interprofessionnels, le rôle des OIP dans l’élaboration et le suivi de ces accords, les conditions d’amélioration de l’exercice de cette mission par l’OIP. -
Fiche 5 : Ressources financières des OIP
La mise en place de mécanismes durables de mobilisation de ressources financières demeure un enjeu majeur dans les organisations interprofessionnelles (OIP). En effet, une des erreurs dans les processus de création des OIP est de ne pas définir en amont, une stratégie de mobilisation des ressources financières propres, permettant de réduire la dépendance aux fonds extérieurs. Conséquence : assurer le fonctionnement des OIP et répondre aux missions que se sont fixées ces structures à leur création demeurent des défis constants du fait du manque de ressources pérennes. Cette fiche « Ressources financières des OIP » présente quelques modalités de financement des OIP, et comment les acteurs des OIP en Afrique de l’Ouest peuvent saisir les opportunités existantes, leur permettant d’assurer un financement durable de leurs missions. -
Rôle des interprofessions dans l'alimentation des marchés urbains
Le présent document porte sur la synthèse de capitalisation des expériences des organisations interprofessionnelles (OIP) en Afrique de l’ouest. Il vise à documenter les initiatives développées par les interprofessions, contribuant à une régulation concertée des marchés agricoles et au renforcement du positionnement des agriculteurs familiaux et des consommateurs urbains sur les filières. Les interprofessions peuvent contribuer à réguler le marché, en atténuant les chocs dus notamment aux fluctuations des prix. -
Analyse organisationnelle et planification stratégique des unions
Le présent «Guide méthodologique» d'appui à 1'« Analyse Organisationnelle et Planification Stratégique» des Unions de la Fédération Mooriben est le résultat du travail Onjoint des équipes -d' Animateurs et Animatrices des Unions, du Secrétaire exécutif de la GPN et des Consultants et Facilitateurs de l'équipe d'appui. -
Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN-NIYA)
La Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN) a été créée en 1996 dans un contexte général qui était favorable à l'association des producteurs (la loi 96/067 du Niger sur les organismes ruraux, libéralisation des économies, désengagement de l'Etat). Après l'adoption de la loi 96-067, FCIVIN est la poursuite de l'Association des Producteurs Maraîchers du Niger (Aspromani). Les principales raisons de la création de la FCMN étaient que les maraichers ne voyaient pas leurs préoccupations prises en compte au sein de l'Union Nationale des Coopératives (étatique) et rencontraient des problèmes d'approvisionnement d'intrants et des problèmes de commercialisation. La FCMN a été reconnue officiellement en tant que fédération par l'arrêté d'agrément 004/CNI du 02 décembre 1998. A sa création, elle consistait de onze coopératives (situées dans les régions de Niamey, Dosso, Tillabéry et Tahoua). Elle regroupe aujourd'hui environ 22.500 producteurs maraîchers répartis dans 123 coopératives dont 18 unions. La fédération a des membres dans toutes les régions du Niger, avec concentration dans les régions d'Agadez et Tillabéry et le Centre Urbain de Niamey. -
Identification et cartographie des activités des OP membres de PFPN
La Plateforme Paysanne du Niger créée en avril 1998 est un cadre organisé de réflexion ; de concertation et d'action des Organisations Paysannes (OP) nigériennes. A sa création elle compte 9 OP membres, aujourd'hui elle en compte 27. Elle est apolitique non lucrative et entièrement indépendante de l'État et de l'administration, non confessionnelle, non discriminatoire et sans distinction de genre. La Plateforme Paysanne est une structure faîtière de type confédération et dans sa composition actuelle, elle regroupe des associations, des fédérations, des unions, des coopératives, des groupements et des OIE. Ses objectifs sont entre autres :
• La constitution d'un cadre d'organisation du monde rural et d'échange, d'expériences autour des politiques de développement ;
• La diffusion et la défense des points de vue des paysans et éleveurs dans la formulation des politiques de développement ;
• La sensibilisation du monde rural en vue d'une gestion et d'une exploitation des ressources naturelles et de l'environnement local et pastoral ;
• La constitution d'un cadre approprié de lobbying pour les activités du monde rural -
La vie en association
Ce document est illustré en image dans le cadre de la vie associative d'un groupement, une organisation. -
Les organisations paysannes nigériennes en mouvement : diagnostic participatif rapide de 20 organisations paysannes
Les 26 et 27 février 2002, 16 organisations paysannes se réunissaient à Torodi à cet effet de réaliser trois objectifs fixés pour cette réunion : . . . • informer et recueillir les avis des participants sur l'initiative de mise en place d'un cadre de concertation des OPA du Niger ; analyser et adopter la démarche opérationnelle de mise en place du Cadre de concertation : • examiner et adopter tes projets de termes de référence du diagnostic des OPA et de l'atelier qui en découlera. -
Les organisations paysannes dans la négociation des politiques agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sénégal
Cette fiche s'intéresse à la problématique de l'implication des organisations paysannes (OP) sénégalaises et ouest africaines dans les négociations des politiques agricoles. Elle est destinée à fournir des outils de compréhension et d'action aux responsables des OP, mais aussi aux autres acteurs de la société civile, et à tous ceux qui s'intéressent au sujet. -
Plan d'affaires de la Fédération SA'A de Maradi pour la commercialisation du souchet à l'export
Le marché du souchet est assez mal connu à cause de son développement récent ; c’est un marché émergent, aussi bien en termes de production qu’en termes de potentiel de marché. Le caractère limité de l’offre sur le marché est dû aux conditions climatiques particulières nécessaires pour la production du souchet. Au niveau international, l’on retrouve la production en Afrique du Nord et tropicale ainsi que dans une petite partie du Sud des Etats Unis. En Europe, l'Espagne est le seul pays producteur. Les principales zones de productions et de transformation sont localisées dans la zone nord de la « Huerta » de Valence et s'étendent sur 6.500 ha (Journal officiel des Communautés européennes – 3-7-1998). -
Les interprofessions des filières agricoles dans la Loi d’orientation agricole du Mali
Cette note présente les articles de la LOA du Mali qui concernent spécifiquement la création et le rôle des interprofessions des filières agricoles. Elle est complétée par une note présentant le décret d’application fixant les modalités de création et d’enregistrement des organisations professionnelles (31 décembre 2008). -
Les interprofessions des filières agricoles : qui peut (doit) participer à une interprofession ? Comparaison des textes sur les interprofessions : France, Mali, Sénégal et l’avant projet du Burkina Faso
Cette note présente une comparaison des textes de loi sur les interprofessions (IP) de France, du Mali et du Sénégal, sur la question des membres et de la composition des interprofessions, à travers les textes réglementaires de ces trois pays qui ont élaboré une loi relative aux interprofessions agricoles1. -
Recensement d'expériences d'interprofession en Afrique de l'Ouest
Ce projet vise à éclairer les décideurs, qu’il s’agisse de leaders paysans, de responsables politiques, d’acteurs économiques des filières agricoles, de responsables de projets ou de la société civile, sur des formes innovantes et performantes d’organisations interprofessionnelles, permettant une régulation concertée des marchés agricoles, au profit de l’ensemble des maillons des filières, et en particulier des agriculteurs familiaux et des consommateurs urbains. Le projet contribuera à promouvoir la concertation entre acteurs au sein des filières agricoles en vue d’un meilleur approvisionnement des centres urbains par les producteurs agricoles familiaux. -
Les organisations interprofessionnelles en Afrique de l’Ouest, des réponses à la libéralisation
Qu’entend-on par organisation interprofessionnelle ?
Comment ces organisations sont-elles apparues, sous l’impulsion de quels acteurs, dans quelles filières et pour répondre à quels enjeux ? Quelles sont les réalités actuelles de ces organisations en Afrique de l’Ouest ? Présentation et analyses.
On assiste depuis 15 ans à l’émergence de nouvelles organisations dans les filières agricoles africaines. Les interprofessions, cadres de concertation, comités interprofessionnels ou tables filières, sont autant de formes d’organisations dites « interprofessionnelles » qui sont apparues ces dernières années, notamment en Afrique de l’Ouest. Ces dispositifs, inconnus auparavant, suscitent aujourd’hui un fort intérêt de la part des acteurs économiques des filières agricoles, des décideurs politiques et des partenaires au développement. Qu’entend-on par organisation interprofessionnelle (OIP) ? Ce terme est utilisé pour désigner le regroupement d’au moins deux « familles » professionnelles (ou « métiers ») présents sur une filière, familles d’acteurs réunies pour dialoguer, se concerter, établir des accords et/ou mener collectivement des actions autour d’un ou plusieurs produit(s) agricole(s). -
Typologie des Organisations Interprofessionnelles dans le monde
La présente note présente un panorama - non exhaustif - des différents types d’OIP dans le monde. L’analyse mettra en exergue, les processus de création des OIP, les spécificités dans leur structuration et leur fonctionnement ainsi que les avantages et limites qui en découlent, et le cas échéant, les évolutions récentes au sein de ces dispositifs interprofessionnels. L’objectif visé est d’éclairer les acteurs ouest-africains sur d’autres formes d’OIP existant dans le monde, pouvant être porteuses d’enseignements et d’innovations dans le contexte interprofessionnel régional. -
Un outil de formation pour le renforcement des interprofessions agricoles en Afrique
Le présent module de formation est inspiré d’un programme intégré de formation et de développement de l’agriculture conçu et mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI) et ses partenaires : Les Savoirs des gens de la terre (LSGT). C’est un outil pédagogique qui permet d’introduire les différents concepts inhérents à l’approche d’interprofession. Il a été élaboré en se basant sur l’expérience québécoise de l’Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi que sur l’expérience d’UPA DI dans plusieurs pays en développement. La version qui suit a été adaptée à la réalité des interprofessions céréalières ouest-africaines. Ce module vise à rendre les représentants au sein des interprofessions aptes à gouverner de manière professionnelle et efficace les destinées de leur organisation. Elle permettra à ces personnes de comprendre ce qu’est une interprofession, son rôle, ses actions possibles, ses forces et les risques associés ainsi qu’identifier quelques éléments essentiels d’un plan d’action annuel et, si nécessaire, réajuster les activités déjà planifiées. -
Les organisations interprofessionnelles agricoles (OIP) en Afrique de l’Ouest
Interprofessions, cadres de concertation, comités interprofessionnels, tables filières, autant de formes d’organisations dites « interprofessionnelles », qui fleurissent ces dernières années en Afrique de l’Ouest et suscitent un fort intérêt de la part des acteurs économiques des filières agricoles comme des décideurs politiques et de certains bailleurs de fonds. -
Les OP passent leurs « marchés » dans la région de Diffa
Le Fonds d’Appui Régional (FAR) s’inscrit dans la composante 2 du programme « Appui au secteur rural des régions de Diffa et de Zinder (PASR) ». Une grande partie du financement est dirigée en subventions à l’endroit des organisations de producteurs, sous forme de microprojets. Les porteurs de ces projets assurent un certain nombre de tâches liées à la maîtrise d’œuvre de leur projet, notamment la passation des marchés et la signature de contrats de prestations. Cette note présente les premières passations de marché réalisées par une coopérative de producteurs et un groupement féminin dans la région de Diffa. -
Rapport de l’atelier de partage et d’échanges d’expérience sur les mécanismes de transfert de technologies de Dosso et Diffa
On a noté une représentation satisfaisante et une participation forte des femmes. Les CRA ont respecté les demandes du RECA (une proportion significative mais de qualité pour garantir une participation effective). Les femmes présentes étaient principalement des productrices d’arachide ou maraîchères avec une expérience très significative tant du point de vue technique que des organisations paysannes. -
Contribution à l’analyse des stratégies d’autofinancement de la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger - Niya (FCMN – Niya)
Au Niger, l’importance des organisations paysannes (OP) a beaucoup accru avec la loi coopérative de 1996, régissant le système coopératif qui a facilité leur émergence et leur développement. Nées dans un contexte complexe, caractérisé par le retrait de l’Etat du secteur agricole et la réticence des institutions financières (IF) à les financer, les organisations paysannes rencontrent des difficultés financières majeures. Cette situation causée par les contraintes liées à l’activité agricole elle-même et la méfiance des IF, entraîne une forte dépendance des OP des partenaires financiers extérieurs. C’est dans ce contexte qu’évolue la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya). Créée en 1996, à l’initiative de 11 coopératives maraîchères, la FCMN-Niya est aujourd’hui forte de plus de 140 coopératives et unions de coopératives. Toutefois, à l’instar des autres organisations paysannes du pays, elle se trouve confronté au problème du financement de ses activités. -
Mouvement coopératif et organisation du monde rural au Niger : bilan, perspectives et propositions pour l'avenir
Cet article est une contribution à la connaissance du mouvement coopératif nigérien : ses péripéties et son rôle dans l'organisation des paysans. Il tire sa substance d'une série d'entretiens que nous avons eus avec les agents de la Direction de l'Action Coopérative du Ministère du développement rural et ceux de l'Union Nationale des Coopératives (UNC)qui ont accepté volontiers de nous fournir la documentation de base de cette étude. -
Le rôle des organisations de producteurs dans les services de conseil rural
Les organisations de producteurs (OP) constituent une interface entre les producteurs et leur environnement social, économique et institutionnel (Encadré 1). L’implication des OP dans la fourniture de services de conseil rural (SCR) est estimée apporter une solution aux limites que posent les dispositifs de conseil étatique jugés trop hiérarchisés et les offres de conseil du secteur privé trop orientés vers des logiques de marché. Les OP peuvent contribuer davantage à l’offre de SCR en exprimant les demandes et besoins de leurs membres et en veillant plus ou moins directement à ce que ces services soient fournis de façon efficace et durable. -
Organisation et rôle de la profession agricole dans le développement des systèmes irrigués : quelques enseignements tirés du cas de l'Office du Niger au Mali
Cette communication traite du rôle des organisations paysannes dans le développement agricole au Mali et en particulier pour la zone de l’Office du Niger. Les politiques d’ajustement, puis maintenant de post-ajustement, donnent un rôle croissant aux organisations paysannes dans divers cadres de concertation où doivent se négocier les politiques sectorielles et se cogérer les filières agricoles. A travers le cas du Mali et plus particulièrement de la zone irriguée de l’Office du Niger (mais aussi de la filière coton), il est mis en en balance les nouveaux enjeux auxquels se trouvent confrontées les organisations de producteurs – extension du domaine aménagé, gestion du périmètre irrigué, amélioration de la productivité – et leurs capacités à les relever, capacités qui sont fortement liées aux diverses conditions de leur émergence. -
Appui et conseil aux organisations paysannes en zone Office du Niger : du projet centre de prestations de services aux « Faranfasi So »
Cette expérience vise à contribuer à la structuration du milieu paysan accompagnant un processus de démocratisation économique et politique. Mais face à l’ampleur des besoins de services, aux difficultés institutionnelles et à l’environnement économique défavorable, quelles perspectives de viabilisation en dehors de toute politique agricole régulatrice ? C'est à travers l'expérience particulière des centres Faranfasi So en zone Office du Niger au Mali que nous proposons de mener cette réflexion. -
Auto-évaluation à mi-parcours du programme d’appui aux organisations paysannes : phase 3
Ce rapport présente les résultats de la mission commandée par le Buco Niamey aux fins de faciliter/ accompagner les organisations paysannes dans un processus d’introspection et de mise en perspective de leurs programmes. -
Problématique du financement des organisations paysannes au Niger : expérience de la fédération des coopératives maraichères du Niger : FCMN-Niya
Dans un contexte de libéralisation économique, marqué par des crises économiques en Occident, le manque d’accès au financement devient une contrainte cruciale pour le développement du monde rural en Afrique. Les organisations paysannes (OP) nées à la faveur de la loi coopérative de 1996, régissant le système coopératif nigérien sont toutes confrontées à cette question du financement avec une acuité. Elles se donnent donc pour objectif de trouver des solutions adéquates pouvant venir à bout de la problématique. Face aux contraintes diverses liées à l’activité agricole, ces organisations paysannes s’organisent et se structurent pour lever lesdites contraintes. Ainsi, la question du financement des activités des organisations paysannes au Niger limite les efforts de ces derniers. Le financement des activités agricoles à travers les institutions financières reste assez timide. Les accords de partenariat entre les institutions financières (banques commerciales ou IMF) et les OP sont le plus souvent limités par la méconnaissance des services financiers par les OP et/ou la méfiance des institutions financières. Malgré le retour de l’Etat Nigérien dans l’appui au monde rural, la problématique demeure d’actualité. C’est donc conscient de cette situation que la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) veut se doter d’une stratégie de financement qui devrait lui permettre d’atteindre son autonomie financière.